
Cette annonce, lourde de conséquences diplomatiques et symboliques, a suscité une vive incompréhension. Elle intervient en plein conflit, dans un contexte encore marqué par les atrocités du 7 octobre 2023, que le Président français lui-même a qualifiées de « pire massacre antisémite de notre siècle ».
Alors que le Hamas n’est pas désarmé, que la bande de Gaza n’a pas été démilitarisée, que la guerre n’est pas terminée, que 59 otages sont toujours retenus dans les tunnels, et qu’Israël n’a pas encore pansé ses plaies ni terminé son deuil, la réponse de la France ne peut être la reconnaissance d’un État né d’un territoire d’où a été lancée une attaque barbare, préméditée, et injustifiable.
Au-delà de l’obscénité morale qu’une telle décision représenterait, elle reviendrait à légitimer la violence, à valider le terrorisme comme levier diplomatique, à renforcer l’instabilité régionale, et à humilier les victimes d’un pays ami et allié.
Les critères de la souveraineté d’un État : une réalité incontournable
La création d’un État ne relève pas d’un simple geste politique ou d’une impulsion émotionnelle. Elle obéit à des critères précis, énoncés par la Convention de Montevideo (1933), qui définit quatre conditions essentielles :
- Un territoire défini: le « territoire palestinien » est morcelé, instable, sans frontières reconnues.
- Une population permanente: la population palestinienne est divisée, exploitée par des factions rivales, et enfermée dans un statut perpétuel de « réfugié » qui se transmet de génération en génération, au sein même de ce territoire – un cas unique dans l’histoire.
- Un gouvernement effectif : deux autorités rivales se disputent le pouvoir, sans légitimité démocratique. À Gaza, le Hamas, organisation terroriste islamiste, contrôle la population par la force. En Cisjordanie, l’Autorité palestinienne, corrompue et autoritaire, n’a plus organisé d’élections depuis près de vingt ans.
- Une capacité à entrer en relation avec d’autres États: le proto-État palestinien a déclaré la guerre à son voisin Israël et participe, avec le parrainage de la République islamique d’Iran, à la déstabilisation du Moyen-Orient.
Il est clair que la société palestinienne et les autorités qui la dirigent ne remplissent aucune de ces conditions. La reconnaissance d’un État qui n’existe pas serait une faute politique et un déni des fondamentaux du droit international.
Qui dirigerait cet État ? Un choix impossible
Si des élections libres étaient organisées demain en Cisjordanie et à Gaza, le Hamas — déjà victorieux dans les urnes en 2006 lors d’un scrutin reconnu par la communauté internationale, symbolisant le rejet des Accords d’Oslo et de la paix avec Israël par une majorité de Palestiniens — l’emporterait très probablement à nouveau.
Ce mouvement islamiste terroriste tire sa légitimité d’une population profondément radicalisée par des décennies d’endoctrinement systématique dans les écoles, notamment celles de l’UNRWA, les médias et les mosquées. Ce conditionnement idéologique, abondamment documenté et régulièrement dénoncé, y compris par la France, glorifie le martyre, célèbre les attentats, et diabolise les Juifs non pas comme adversaires politiques, mais comme ennemis existentiels à éradiquer.
Et si ce n’est pas le Hamas, ce serait le Fatah, dirigé par Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, désormais dans la 21e année de son mandat de cinq ans. Ce régime autoritaire, miné par la corruption, continue de verser des salaires mensuels aux terroristes détenus en Israël via le « Fonds des Martyrs » — une incitation institutionnalisée à la violence. Toujours perçu comme l’interlocuteur officiel des Palestiniens par les chancelleries occidentales, Mahmoud Abbas n’a jamais condamné les massacres du 7 octobre. Pire encore, des membres de ses forces de sécurité, reconnaissables à leurs bandeaux jaunes, ont activement participé aux atrocités, et continuent de prendre part aux cérémonies macabres de restitution de corps et d’otages.
Deux visages, une même matrice idéologique : celle du rejet d’Israël en tant qu’État juif, de la sacralisation de la lutte armée, et de la négation de toute perspective de coexistence pacifique. Le 7 octobre n’a pas marqué une rupture pour ces deux leaderships : il en a plutôt révélé la nature profonde. Une nature structurée non pas autour de la construction d’un État, mais autour de la destruction de l’autre. Ce jour-là, la cause palestinienne a levé le masque.
Dans ce contexte, évoquer la « solution à deux États » revient à poser une équation politique dont toutes les inconnues sont déjà connues : tant que les seules alternatives demeurent le Hamas ou le Fatah, il n’existe pas de partenaire crédible pour la paix — seulement des variantes d’un même refus, d’une même haine.
Reconnaitre aujourd’hui un proto-État belliqueux sans savoir qui le dirigera demain, c’est faire preuve d’amateurisme, d’aveuglement et d’inconscience.
Le mythe du « peuple palestinien »
Israël est né dans le droit. La déclaration Balfour (1917), la lettre Cambon marquant la reconnaissance française, la conférence de San Remo (1920), puis le mandat confié au Royaume-Uni par la Société des Nations, avec pour objectif explicite l’établissement d’un foyer national juif, ont jalonné les fondations légales de l’État d’Israël moderne. Ce processus a culminé avec la résolution 181 de l’ONU (1947), qui prévoyait la partition de la Palestine mandataire — déjà amputé par la création de la Jordanie — en deux autres États, l’un juif, l’autre arabe.
Les Juifs ont accepté ce compromis, malgré les concessions douloureuses qu’il impliquait. Les pays arabes, eux, l’ont systématiquement rejeté, au nom d’un refus catégorique de toute présence juive souveraine, pourtant sur leurs terres ancestrales – une réalité contestable pour quiconque fait preuve de bonne foi.
Le « peuple palestinien », à l’époque inexistant, n’a pris part à aucune négociation. Ce sont les États arabes eux-mêmes qui ont refusé la création d’un nouvel État arabe appelé « Palestine ».
Ce refus s’est traduit, dès le lendemain de la déclaration d’indépendance d’Israël, en mai 1948, par une guerre d’anéantissement, menée par cinq armées arabes coalisées. Cette hostilité structurante ne s’est jamais réellement estompée. Face à l’échec militaire et diplomatique, une nouvelle stratégie s’est mise en place : substituer au récit juridique de la légitimité israélienne une narration victimaire, centrée sur un concept inédit dans l’histoire régionale : celui de « peuple palestinien ».
Ce concept, dans son acception politique contemporaine, n’émerge véritablement qu’à partir des années 1960, sous l’impulsion conjointe de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et de l’Union soviétique. Dans le contexte de la guerre froide, Moscou perçut dans la cause palestinienne un levier stratégique pour fragiliser les puissances occidentales, en particulier les États-Unis et leur allié israélien.
L’OLP, fondée en 1964 — soit trois ans avant même que la Cisjordanie et Gaza ne soient conquises par Israël lors de la guerre défensive des Six Jours —, n’avait pas pour objectif initial la création d’un État vivant aux côtés d’Israël. Sa vocation première était claire : « libérer la Palestine », c’est-à-dire anéantir Israël.
Ainsi, la construction identitaire palestinienne ne s’est pas bâtie autour d’un projet de nation, mais comme une entreprise de délégitimation.
Il ne s’agissait pas de bâtir un État démocratique et pacifique, mais de délégitimer pour effacer l’existence d’un État juif, en niant ses fondements historiques et juridiques. Ce récit a été relayé, amplifié, puis progressivement intégré par une partie de la communauté internationale, jusqu’à inverser les termes du conflit : les survivants de la Shoah, revenus sur leur terre après deux mille ans d’exil et un génocide, ont été qualifiés de « colonisateurs », tandis que les populations arabes citoyens de Jordanie, d’Égypte ou de Syrie, devenaient les « victimes » d’un prétendu vol territorial.
Ce renversement du narratif constitue le cœur du malentendu contemporain. Reconnaître un État palestinien sans reposer sur les faits, le droit et la réalité des intentions, revient à légitimer une construction idéologique, non pas née du désir de vivre, mais fondée sur la volonté d’empêcher l’autre d’exister.
Les Arabes et Palestiniens ont déjà dit non à un État
La reconnaissance d’un État palestinien est souvent brandie comme un impératif moral, une réparation tardive à une injustice présumée. Pourtant, l’histoire montre une vérité gênante : à chaque fois qu’un État leur a été proposé, les dirigeants arabes, agissant au nom des Arabes palestiniens ont dit non.
Non à la paix, non à la coexistence, non à Israël.
- 1937 – Plan Peel : première proposition de partage de la Palestine mandatée. L’État juif proposé ne couvre que 20 % du territoire. Les Juifs l’acceptent. Les Arabes refusent catégoriquement et appellent à la violence.
- 1947 – Plan de partage de l’ONU (résolution 181) : les Nations Unies proposent deux États, l’un juif, l’autre arabe. Israël accepte, malgré un territoire réduit, morcelé, sans Jérusalem. Les pays arabes rejettent, déclenchent une guerre d’anéantissement.
- 1967 – Conférence de Khartoum : après la guerre des Six Jours, Israël propose de restituer des territoires en échange de la paix. Réponse arabe : le « triple non » — pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance, pas de négociation.
- 2000 – Sommet de Camp David : à la suite de la signature des Accords d’Oslo en 1993, le Premier ministre israélien Ehud Barak, avec la médiation du Président américain Bill Clinton, propose un État palestinien sur près de 92 % de la Cisjordanie, la totalité de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Yasser Arafat refuse, ne fait aucune contre-proposition, et déclenche la deuxième Intifada, qui a fait plus de 1 000 morts Israéliens et 7 000 blessés.
- 2008 – Offre d’Ehud Olmert à Mahmoud Abbas : 97 % de la Cisjordanie, échange de terres, statut spécial pour les lieux saints de Jérusalem. Abbas n’a jamais répondu à l’offre.
- 2016 – Initiative française pour la paix : portée par Paris, soutenue par les Européens, cette tentative diplomatique est rejetée par les Palestiniens, qui dénoncent une illusion de paix.
- 2020 – Plan Trump : proposé par les États-Unis, il prévoyait un État palestinien démilitarisé, avec capitaux massifs pour le développement économique. Là encore, rejet total de l’Autorité palestinienne, qui coupe les ponts avec Washington.
Et à chaque fois, la réponse palestinienne a été le silence, le rejet ou la violence. Ce n’est pas par manque d’opportunités que l’État palestinien n’existe pas : c’est par rejet volontaire. Refus d’un État aux côtés d’Israël, au profit d’un rêve d’un État à la place d’Israël.
Ce refus d’un État palestinien par les Palestiniens n’est ni tactique, ni ponctuel. Il est structurel, stratégique, idéologique. Il découle d’un rejet profond et constant de l’existence même d’un État juif souverain. Depuis 1948, la logique dominante du nationalisme arabe, puis palestinien, n’a pas été la construction d’un État viable et pacifique, mais la destruction de l’État d’Israël, purement et simplement.
À chaque opportunité de paix, le nihilisme l’a emporté. À chaque compromis, la radicalité a répondu.
Ce n’est pas un projet d’émancipation qui a guidé le mouvement palestinien, mais une politique de haine érigée en identité. La glorification du « martyre », l’éducation à la haine de l’autre, l’appel à la résistance éternelle ont supplanté toute volonté de construire un État moderne et responsable.
Les Palestiniens n’ont pas « manqué » les occasions. Ils les ont sabotées. Délibérément.
Alors pourquoi la France, aujourd’hui, accorderait-elle aux Palestiniens ce qu’ils ont toujours rejeté ? Pourquoi récompenser le refus par la reconnaissance ? Pourquoi récompenser ceux qui ont préféré le conflit à la paix, l’escalade à la négociation, la victimisation à la responsabilité ?
S’il y a la guerre, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’État palestinien. C’est parce que la guerre est le projet et que la « solution à deux États » n’a jamais été à l’ordre du jour.
La création d’un 22ᵉ État arabe — radicalisé, islamisé, gangrené par la corruption et le terrorisme — ne conduira pas à la paix. Elle consolidera les logiques de guerre. Elle légitimera la haine, et non la coexistence.
Ce n’est qu’une fois la paix construite avec l’ensemble du monde arabe – fondée sur la reconnaissance et la légitimité mutuelle, la sécurité, la fin de l’incitation à la haine et la violence – qu’une solution politique pourra être trouvée, y compris pour les Arabes de Palestine. Mais cela suppose, d’abord, qu’ils choisissent réellement la paix.
Une reconnaissance contre-productive
Reconnaître aujourd’hui un État palestinien ne relèverait pas d’un geste de paix, mais d’un acte lourd de conséquences. Loin de favoriser une issue positive au conflit, une telle décision constituerait une erreur stratégique, politique et morale.
Elle reviendrait à :
Justifier le terrorisme : En envoyant le signal que le massacre de civils — comme celui perpétré le 7 octobre 2023 — peut se traduire en gains diplomatiques. Ce précédent créerait une incitation dangereuse à la violence, et renforcerait les acteurs extrémistes qui font de la terreur un levier politique.
Récompenser des régimes autoritaires et mafieux : L’Autorité palestinienne, minée par la corruption, et le Hamas, organisation islamiste et terroriste, ne respectent ni les droits humains, ni les principes démocratiques. Offrir une reconnaissance à des entités qui piétinent la liberté d’expression, répriment leur population et encouragent la haine des Juifs institutionnalisée, c’est légitimer des pratiques profondément contraires aux valeurs occidentales.
Saper toute perspective de paix durable : En court-circuitant le processus de négociation, seule voie légitime et crédible vers une solution équilibrée. Imposer un État sans compromis ni engagement mutuel revient à enterrer toute possibilité de dialogue futur, au profit d’un rapport de force brutal et unilatéral.
Violer les critères du droit international : La Convention de Montevideo (1933) stipule des conditions précises pour la reconnaissance d’un État : territoire défini, population stable, gouvernement effectif, capacité diplomatique. Aucune de ces conditions n’est remplie aujourd’hui. Une reconnaissance précipitée reviendrait à contourner le droit au profit de considérations émotionnelles et idéologiques.
Humilier les victimes du 7 octobre : Alors que 59 otages sont toujours retenus à Gaza, que les familles endeuillées n’ont pas obtenu justice, une telle reconnaissance apparaîtrait comme une trahison morale. Elle reviendrait à accorder une prime à la barbarie, au lieu d’exiger la vérité, la responsabilité et la justice.
Menacer la stabilité régionale : Un État palestinien tel qu’il se dessine aujourd’hui serait un voisin hostile – pour Israël comme pour la Jordanie et l’Égypte –, gouverné par des factions qui refusent toujours de reconnaître l’État juif et appellent à sa destruction. Ce ne serait pas un partenaire de paix, mais un foyer d’instabilité parrainé par la République islamique d’Iran au cœur d’un Moyen-Orient déjà fragilisé.
L’histoire récente l’a prouvé : concessions = violence
Chaque initiative israélienne en faveur de la paix s’est soldée non par une accalmie, mais par une escalade de la violence :
- Accords d’Oslo (1993) : vague d’attentats.
- Retrait du Sud-Liban (2000) : renforcement du Hezbollah, proxy iranien.
- Retrait de Gaza (2005) : prise de pouvoir du Hamas.
À chaque fois, Israël a agi seul. Et à chaque fois, la réponse fut la haine, la guerre, la terreur — pendant que la communauté internationale, prompte à exiger des concessions, restait silencieuse face aux conséquences.
Mais reconnaître un État palestinien dans le contexte actuel, ce n’est pas seulement une faute géopolitique et stratégique, qui nuirait à un pays ami et allié de la France au Moyen-Orient ; c’est aussi prendre le risque d’alimenter des tensions déjà explosives sur le sol français.
Les massacres du 7 octobre 2023 contre Israël ne sont pas un événement isolé. Ils marquent aussi le début d’une offensive globale des islamistes contre l’Occident, contre la civilisation, contre la liberté, contre l’idéal universel qui unit les peuples libres.
Dès le lendemain, le conflit initié au Proche-Orient par le Hamas s’est propagé en France. Depuis, la haine des Juifs a explosé : agressions verbales et physiques, attaques contre des synagogues, inscriptions nazies, menaces contre des écoles juives. Plus de 1 600 actes antijuifs ont été recensés en 2023, plus de 1 500 en 2024. Des chiffres terrifiants, inacceptables, qui témoignent d’un climat délétère que l’État peine à juguler.
Dans les cortèges propalestiniens, on entend désormais des slogans appelant à une intifada mondiale, à la haine d’Israël — et, par un glissement dangereux, à la haine des Juifs – mais aussi à la haine de la France.
La nouvelle haine des Juifs a parachevé sa mue commencée il y a plusieurs décennies : celle de la haine d’Israël, devenue l’obsession des islamistes, de ses collaborateurs d’extrême gauche, dont l’objectif est de mener le combat contre la République en sapant le socle de ses valeurs. Ces discours ne sont plus confinés à des marges radicales, ils sont relayés sur les réseaux par des influenceurs, des figures médiatiques, mais aussi par des élus, notamment ceux de La France Insoumise.
Les islamistes nous ont collectivement désignés comme l’ennemi à abattre dans la guerre qu’ils mènent contre toutes les démocraties, et particulièrement la France, clef de voûte de notre civilisation.
Dans ce climat, reconnaître un État palestinien serait perçu comme une victoire idéologique par les tenants d’un communautarisme radicalisé. Ce serait alimenter un feu déjà dangereux : celui d’une haine décomplexée, d’un rejet frontal des valeurs républicaines, d’un appel déguisé à l’épuration : « From the River to the Sea ».
Ce serait, in fine, compromettre la sécurité de centaines de milliers de citoyens juifs, mais aussi de tous les Français, face à la menace islamiste. Car aujourd’hui, en France, Juif ou non, plus personne n’est en sécurité.
La République ne peut – ne doit – sacrifier ses enfants sur l’autel d’un geste diplomatique vide de sens, dicté par la pression, l’émotion ou la posture politique. On ne bâtit pas la paix en validant la haine. On ne défend pas la justice en désarmant la vérité. Et on ne protège pas la République en cédant à ceux qui veulent la fracturer.
La paix ne se décrète pas, elle se construit
Affirmer que la reconnaissance d’un État palestinien serait « un pas vers la paix » relève d’un aveuglement dangereux. La paix ne naît ni de gestes symboliques ni de postures diplomatiques. Elle ne découle pas de la récompense du terrorisme ou de la peur de l’émotion populaire. Elle se construit patiemment, sur la base de principes clairs : la sécurité, la responsabilité, la fin de la haine.
Reconnaître aujourd’hui un État palestinien, c’est intégrer dans l’ADN même de cette entité le Hamas, organisation terroriste islamiste, coupable du plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. C’est ériger le 7 octobre 2023 — jour de barbarie absolue, de viols systématiques, de meurtres d’enfants, de prises d’otages — en mythe fondateur d’une prétendue nation.
En soutenant cette reconnaissance, Emmanuel Macron s’enferme dans un raisonnement pervers : celui selon lequel le terrorisme de masse serait l’expression d’une frustration que l’on pourrait apaiser par un État. Cette thèse est fausse, historiquement et moralement. Car elle revient à dire qu’assassiner des civils peut devenir un levier diplomatique. C’est légitimer la barbarie, normaliser l’horreur, et ouvrir la voie à sa répétition — jusqu’à l’extermination d’Israël et de son peuple, comme le Hamas le promet explicitement.
Les Israéliens, longtemps favorables à une solution à deux États, ont vu leur main tendue broyée par la haine armée. Aujourd’hui, plus des trois quarts d’entre eux s’y opposent. Non par idéologie, mais par lucidité : comment envisager la paix avec ceux qui enseignent à leurs enfants que tuer des Juifs est un devoir ?
La seule voie vers la paix passe d’abord par un accord global avec le monde arabe, sur le modèle des Accords d’Abraham, incluant la reconnaissance pleine et entière de l’État juif et de sa légitimité à exister.
Puis, par une solution négociée, acceptée par Israël, garantie par des engagements fermes, concrets et irréversibles :
- Retour de tous les otages
- Démantèlement des organisations terroristes
- Démilitarisation de la bande de Gaza
- Démantèlement de l’UNRWA
- Fin de l’endoctrinement à la haine
- Réforme en profondeur de l’Autorité palestinienne
- Fin de la guerre
La paix ne viendra jamais de l’existence d’un État palestinien : elle est la condition préalable à son éventuelle émergence. La reconnaissance d’un tel État ne peut être que l’aboutissement d’un processus de paix, pas son point de départ.
Et tant que cette paix n’est pas construite, pas garantie, pas même désirée par ceux qui se disent prêts à la recevoir, la France ne peut céder à l’illusion, au nom de ses principes. Toute reconnaissance unilatérale serait une capitulation.
Car la France, patrie des Lumières, des droits de l’Homme, de la raison et de la justice, ne peut reconnaître un État fondé sur la haine, la corruption et le refus de l’autre. Elle ne peut trahir son histoire, ses principes, ni renier son amitié fidèle et précieuse avec Israël.
Reconnaître aujourd’hui un État palestinien, c’est nier les faits, bafouer le droit, trahir nos valeurs. C’est se tromper de combat. C’est faire, au fond, le choix de l’injustice.









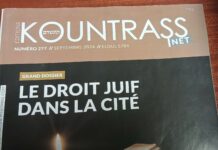


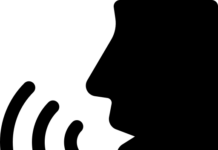
















« Il est clair que la société palestinienne et les autorités qui la dirigent ne remplissent aucune de ces conditions. La reconnaissance d’un État qui n’existe pas serait une faute politique et un déni des fondamentaux du droit international. » Pourquoi toujours parler de société palestinienne, alors qu’il s’agit d’une société arabe et au mieux gazaouie ? Pourquoi parler du droit international, alors que c’est devenu un prétexte à couvrir les pires manifestations d’antisémitisme, les pires massacres un peu partout dans le monde ?
« La seule voie vers la paix passe d’abord par un accord global avec le monde arabe, sur le modèle des Accords d’Abraham, incluant la reconnaissance pleine et entière de l’État juif et de sa légitimité à exister. » Et l’annexion pure et simple de Gaza e de la Judée-Samarie, l’anéantissement du hamaSS er du Hezb…h, la dissolution de l’Autorité palestinienne, et l’émigration « volontaire » des arabes qui refusent la citoyenneté israélienne.
La reconnaissance d’un état palestinien n’est que le fantasme d’un esprit malade, ni plus, ni moins.
IL faut que le gouvernement israélien sorte de la diplomatie avec la France, la France est notre ennemie. Depuis la Shoah, les Français n’ont pas changé, ils sont antisémites, et Macron est pire que les autres. Il faut que nos professeurs qui participent à la recherche quittent ce pays, que notre ambassadeur quitte la France.