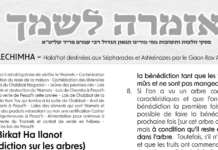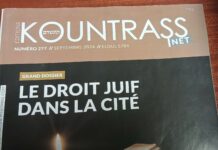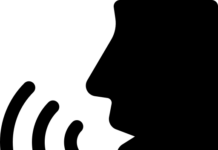Depuis le 24 février 2022, jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la position israélienne demeure prudente dans le but de sauvegarder les intérêts et maintenir des relations correctes avec les deux pays. Cependant, les violentes attaques verbales et les accusations humiliantes de Donald Trump à l’égard du président Zelensky, mettent dans un profond désarroi les Européens, modifient les alliances stratégiques et devraient inquiéter aussi Israël. Pourquoi Trump brouille brusquement toutes les cartes, brise les alliances occidentales, adopte la propagande russe et choisit de reprendre le dialogue avec la Russie en Arabie saoudite ? Ne risque-t-il pas de tomber dans le piège de Poutine ? Ignore-t-il qu’on ne peut comprendre la Russie avec la raison. Winston Churchill disait justement : « La Russie est un rébus enveloppé de mystère au sein d’une énigme. »
Tous les experts en géopolitique, les services de renseignement, et les anciens généraux, prétendent de connaître la marche à suivre, mais en réalité, ils ignorent les véritables intentions du maître du Kremlin, cet ancien officier du KGB qui souhaite sortir de l’isolement international et lever les sanctions contre son pays. Une évidence, et Trump devrait le savoir, tant que Poutine n’obtiendra pas toutes ses revendications, un retrait définitif des troupes russes de l’Ukraine est exclu. Pour Poutine, le cas ukrainien est dissemblable par rapport aux autres conflits car il s’agit de régler un vieux contentieux interne puisque « ce pays fait partie intégrale de la grande Russie ».
Le but de Poutine est de démilitariser l’Ukraine, d’élargir le contrôle des frontières de son empire par un nouveau « rideau de fer » et des régimes pro-russes. L’objectif préoccupe profondément la Pologne, la Finlande et tous les pays baltes.
Illustration : A Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a participé à une réunion trilatérale avec le président français Emmanuel Macron et le président élu américain Donald Trump.
Il est clair aussi que Poutine avait osé envahir l’Ukraine en raison de la faiblesse de l’administration Biden et de l’OTAN, surtout quand un président américain lui affirme à l’avance, qu’il n’enverra pas de soldats pour défendre les Ukrainiens. Rappelons que nous avons permis à l’armée américaine d’utiliser leurs stocks de munitions entreposés dans nos bases pour les offrir à l’Ukraine.
Depuis la Guerre froide, la politique étrangère du Kremlin n’a pas vraiment évolué au Moyen-Orient. L’ex-Union soviétique possède l’art de faire monter les enchères et de raviver la tension dans le monde, mais à ce jour, elle n’a pas disposé de moyens opérationnels pour mettre un terme aux crises régionales ou faire progresser un processus de paix équitable.
Cependant, durant toutes ces années, l’histoire des rapports entre Moscou et Jérusalem est une longue suite de disputes, de froideurs, de ruptures et de réconciliations. Une première crise surviendra en février 1953, suite à un attentat perpétré contre la mission soviétique à Tel-Aviv. En 1956, suite à la campagne de Suez, le maréchal Boulganine menace d’utiliser l’arme atomique. Après la guerre des Six Jours, l’Union soviétique, et avec elle tout le bloc communiste, rompt ses relations diplomatiques avec Israël. Durant la Guerre d’usure le long du canal de Suez, des avions MIG pilotés par des Russes ont été abattus par la chasse israélienne…En octobre 1991, suite à l’effondrement de l’URSS, les relations diplomatiques sont renouvelées et une lourde page est tournée entre les deux pays. Elles atteindront leur apogée lors de l’avènement de Vladimir Poutine.
Deux décennies plus tard, suite à l’intervention russe dans la guerre civile syrienne et devant les intentions hégémoniques de l’Iran, les relations militaires se sont renforcées avec la création d’un mécanisme qui évite toute confrontation directe avec Tsahal. Désormais, toutes les frappes contre le Hezbollah ont été annoncées à l’avance et Poutine a donc laissé poursuivre les raids contre l’Iran et le Hezbollah. Suite à la guerre en Ukraine et avec la chute récente de Bachar el Assad, la Russie est moins active dans notre région mais demeure incontournable sur le plan international.
Depuis le 7 octobre 2023, nos relations avec la Russie se sont sensiblement refroidies mais elles n’ont pas abouti à la rupture comme ce fut le cas après la guerre de 1967. Moscou poursuit son soutien inébranlable à la cause palestinienne et demeure un allié stratégique de la Chine, de l’Iran et de la Corée du Nord. Ce nouvel axe stratégique inquiète beaucoup les Américains. Ils préfèrent donc le neutraliser et renforcer leurs forces navales dans l’océan indien et dans le Pacifique plutôt qu’en Méditerranée.
Israël fait partie du camp démocratique occidental et dépend de la politique étrangère des Etats-Unis. L’Europe est plus que jamais divisée. L’urgent voyage à Washington du président français, Emmanuel Macron, pour que Trump reconsidère ses intentions sur l’Ukraine et son plan de créer une nouvelle défense européenne indépendante seront probablement voués à l’échec.
Dans le contexte géopolitique actuel, face à la faiblesse de la sécurité européenne, et devant les intentions hégémoniques de Poutine, nous ne pouvons suivre aveuglement la logique de Donald Trump sur la solution de la crise russo-ukrainienne. D’ailleurs, soyons modestes, nous n’avons pas les moyens pour influer sur la marche politique des superpuissances. Nous devrions donc maintenir avec la Russie des relations bilatérales normales sans lui offrir une médiation pour régler le conflit arabo-israélien.
La présence de communautés juives en Ukraine et en Russie et le nombre considérable de russophones en Israël sont toujours pris en considération dans nos relations diplomatiques. Leur passé historique, les pogroms et le fléau de l’antisémitisme sont ancrés dans notre mémoire collective. Une situation délicate, complexe et symbolique, d’autant plus que les parents du président Ukrainien, Volodymyr Zelensky, sont d’origine juive et russophones. Mais au-delà du devoir moral, comment aussi sauvegarder les intérêts diplomatiques et stratégiques avec la Russie et nos relations commerciales avec l’Ukraine qui nous fournit la majorité écrasante de nos denrées alimentaires ?
Sur un sujet si sensible et si compliqué, la position israélienne devrait être réfléchie et claire, en calculant minutieusement tous les enjeux communautaires, régionaux et internationaux, et en sauvegardant les intérêts diplomatiques et stratégiques acquis.