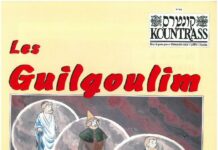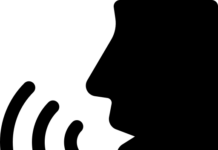Le bouclier israélien pour les Druzes en Syrie et le bouleversement régional que personne n’attendait
Au lendemain de bouleversements majeurs au cœur du Moyen-Orient, Israël opère un virage stratégique inattendu en proposant sa protection aux Druzes syriens. Jadis impensable, cette initiative traduit l’évolution des alliances et la transformation des équilibres régionaux. Alors que l’État hébreu n’avait jamais envisagé de s’impliquer dans la défense d’une minorité perçue comme traditionnellement liée aux régimes syriens, la réalité d’un Moyen-Orient en mutation oblige désormais Tel Aviv à repenser ses priorités sécuritaires et diplomatiques.
Il y a encore peu, la chute du régime d’Assad faisait partie intégrante d’un paysage régional qui ne laissait guère de place à l’intégration des Druzes syriens sous l’égide israélienne. Toutefois, les événements récents – notamment les déclarations véhémentes du Premier ministre Benjamin Netanyahou après le massacre du 7 octobre – ont précipité un changement de cap. Dans un discours adressé aux jeunes officiers de Tsahal, Netanyahou proclamait : « Nous allons changer le visage du Moyen-Orient ». Ce message fort s’est rapidement concrétisé par des mesures concrètes visant à isoler les forces armées du nouveau régime syrien.
Netanyahou a ainsi affirmé qu’Israël n’autoriserait pas l’entrée de l’armée syrienne dans la zone située au sud de Damas. Il a exigé, de surcroît, la démilitarisation totale des provinces de Quneitra, Daraa et Suwayda, tout en précisant que toute menace envers la communauté druze dans le sud de la Syrie serait impitoyablement réprimée. Par cette déclaration, Israël envoie un signal clair aux dirigeants de Damas : la sécurité des Druzes – minorité aux attaches historiques et familiales avec Israël – ne saurait être compromise.
Les raisons d’un engagement inédit
Plusieurs facteurs expliquent ce virage stratégique. D’une part, la communauté druze en Israël, reconnue pour son engagement et ses sacrifices dans l’armée, entretient des liens étroits avec ses homologues du côté syrien. Nombreux sont ceux qui ont des proches de l’autre côté de la frontière et qui, face aux incertitudes grandissantes et aux violences perpétrées durant la guerre civile syrienne, réclament une protection renforcée. Les Druzes de la région du Golan, par exemple, ont progressivement vu leur identité se rapprocher de celle d’Israël, comme en témoigne l’acquisition récente de la citoyenneté par environ un cinquième des 27 000 Druzes de cette zone.
D’autre part, les tragédies survenues pendant la guerre civile – dont le massacre de Soueida en 2018, qui a coûté la vie à plus de 200 personnes et laissé plusieurs otages – ont exacerbé la peur des factions islamistes. Ces événements ont fait naître une méfiance profonde envers le nouveau gouvernement syrien, dont certains responsables entretiennent encore des liens ambigus avec des groupes extrémistes. Dans ce contexte, étendre une protection militaire et politique aux Druzes syriens apparaît comme une démarche logique, à la fois pour sécuriser une communauté vulnérable et pour affaiblir l’influence des acteurs islamistes dans la région.
Un écho historique et une vision d’avenir
L’idée d’une alliance avec les Druzes n’est pas nouvelle. Dès la guerre des Six Jours, le ministre Yigal Alon avait évoqué la création d’un État druze s’étendant du Golan au sud de la Syrie, destiné à servir de tampon entre Israël, la Syrie et la Jordanie. Bien que cette proposition n’ait jamais abouti, elle démontre qu’un lien historique et stratégique existait déjà. Aujourd’hui, l’offre de protection formulée par Netanyahou renouvelle cette vision d’un partenariat qui pourrait stabiliser des zones historiquement conflictuelles et offrir une alternative aux forces radicales.
Implications régionales : le cas libanais
Parallèlement, des développements au Liban témoignent d’une mutation des alliances traditionnelles. Alors que des centaines de milliers de personnes se rassemblèrent à Beyrouth pour les funérailles du chef assassiné du Hezbollah, Hassan Nasrallah, un vent de changement se faisait sentir. La rencontre entre le président libanais, Joseph Aoun, et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a pris une tournure surprenante. Aoun a clairement exprimé son ras-le-bol face aux ingérences extérieures en affirmant que le Liban ne souhaitait plus être un pion dans le jeu régional opposant l’Iran à Israël. En soutenant ouvertement une solution à deux États – qui reconnaît implicitement l’existence d’Israël – Aoun marque une rupture avec la ligne traditionnelle du Hezbollah, historiquement opposé à toute reconnaissance de l’État juif.
Les récentes déclarations et initiatives d’Israël, associées aux évolutions politiques au Liban, témoignent d’un renouveau stratégique au cœur d’un Moyen-Orient en pleine recomposition. En étendant sa protection aux Druzes syriens, Tel Aviv ne se contente pas de défendre une minorité ; elle redéfinit les contours d’un nouvel ordre régional, où la sécurité et les alliances se réinventent face aux défis contemporains. Cette démarche, audacieuse et risquée, vise à prévenir l’essor des forces extrémistes et à stabiliser des zones clés, tout en honorant les liens historiques et familiaux qui unissent les communautés druzes. Dans ce contexte, l’évolution de la politique israélienne reflète la nécessité d’adapter les stratégies nationales aux réalités géopolitiques mouvantes du Moyen-Orient.
Jforum.fr – Illustration : soldats druzes servant dans Tsahal