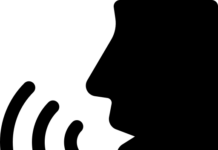Par Daniel Pipes et Michael Rubin
MEF Observer – Adaptation française: Gilles de Belmont
Après le gel par le président Donald Trump des subventions de l’Agence des États-Unis pour le développement international (United States Agency for International Development, USAID), son administratrice sortante, Samantha Power, avait peine à trouver ses mots au moment où elle s’efforçait d’exprimer son indignation : Les programmes que nous menons, les personnes dont nous dépendons, dans certains cas, pour des médicaments qui sauvent des vies. … Ou si vous êtes au Soudan et que vous avez un enfant qui dépérit à cause de la malnutrition, une pâte miracle, une pâte d’arachide fournie par l’USAID qui éloigne cet enfant du précipice de la mort – tous ces programmes sont fermés.
En clair : Ne touchez pas à l’USAID !
Le réexamen complet de l’USAID est très attendu depuis longtemps et d’une urgente nécessité.
Cependant, Power a soigneusement ignoré toute une série de scandales liés à l’USAID, tels que les 122 millions de dollars envoyés par l’Agence, alors en grande partie sous le contrôle de Power, à des groupes alignés sur des entités désignées comme terroristes. En d’autres termes, le réexamen complet de l’USAID qui commence désormais est très attendu depuis longtemps et d’une urgente nécessité.
L’aide internationale, c’est-à-dire le soutien financier d’un pays à un autre, est un phénomène qui a pris de l’importance il y a quatre-vingts ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux facteurs ont motivé sa croissance : d’une part, la dévastation des économies avancées d’Europe et d’autre part, le désir de soutenir ou de gagner des alliés dans le contexte de la Guerre froide naissante.
| L’économiste britannique Peter T. Bauer. |
C’est alors devenu une pratique bien établie et routinière dans les relations internationales. Malgré les critiques acerbes, s’est répandu le principe selon lequel les pays les plus riches doivent consacrer une partie de leurs ressources aux plus pauvres ou, selon le célèbre mot d’esprit de l’économiste britannique Peter Bauer, « l’aide au développement est un système qui consiste à prendre de l’argent aux pauvres des pays riches et à le donner aux riches des pays pauvres ».
Le succès du plan Marshall ressenti en Europe et celui de son équivalent au Japon ont créé l’espoir que l’argent soigneusement investi permettrait de faire passer les pays de la pauvreté à la richesse. Toutefois, une expérience de près d’un siècle a montré qu’ils s’agit là d’une chimère. Tout pays qui s’est développé l’a fait de son propre chef. On peut affirmer que l’argent gratuit que représente l’aide internationale fausse les économies et entrave le développement.
Si on met l’aide au développement de côté, il reste trois types d’aide de base : les couvertures (d’urgence), les bombes (militaire) et les pots-de-vin (politique). L’aide d’urgence équivaut à de la charité, à l’aide aux populations en crise. Au-dessus de toute controverse et relativement peu coûteuse, elle ne relève pas de la compétence du département d’État et il reviendrait peut-être au département de l’Intérieur de s’en occuper. L’aide militaire contribue à la réalisation des objectifs de Washington en aidant un allié à se battre. Elle appartient sans conteste au département de la Défense. L’aide politique, c’est-à-dire l’encouragement des gouvernements à adopter les politiques souhaitées par Washington par rapport à des objectifs très spécifiques, constitue un outil important de la diplomatie et a donc sa place au département d’État.
Pour en revenir aux remous actuels, l’administration Trump n’a pas mis fin à l’aide étrangère mais se demande si cette aide sert le contribuable américain. Une telle comptabilité permettra de constater que l’USAID échoue principalement de trois manières.
Premièrement, à l’instar de tout système bureaucratique, elle a tendance à considérer la dépense des fonds comme une mesure de succès. Pour ne citer qu’un exemple tristement célèbre, elle s’est vantée de s’être investie dans la lutte contre le paludisme en Afrique alors qu’elle a dépensé 95 % de ses fonds pour des consultants et des entrepreneurs, et seulement 5 % pour l’aide médicale. Ce n’est qu’au prix des questions persistantes posées par les commissions du Congrès que l’USAID a admis que les chiffres qu’elle a cités n’avaient aucun rapport avec ce qu’elle a réellement fait sur le terrain.
| Le Premier ministre albanais Edi Rama. |
Deuxièmement, l’USAID a tendance à considérer l’aide comme un droit. Quand le travail d’un fonctionnaire ou d’un diplomate américain dépend de la distribution d’aide, celle-ci continue à couler, quelle que soit son utilité. Prenons l’Albanie, où le contribuable américain a investi près de 30 millions de dollars dans la réforme judiciaire au cours des six dernières années, période durant laquelle non seulement la corruption a augmenté mais en plus, le dirigeant albanais Edi Rama a détourné l’aide anti-corruption pour réduire au silence et emprisonner ses concurrents. À l’heure actuelle, le gouvernement albanais est devenu une mini-Turquie, caractérisé par une démocratie en lambeaux, un parti au pouvoir corrompu et une hostilité envers l’Occident. Indifférente, l’USAID continue à faire couler l’argent.
Un problème similaire affecte l’aide militaire. Quand le Pakistan et l’Égypte reçoivent des milliards de dollars pour repousser les groupes terroristes islamistes, l’intérêt pour eux est de maintenir ces groupes en vie. La corruption individuelle donne alors aux chefs militaires encore plus de raisons de maintenir vivace la menace islamiste.
L’USAID ignore l’impact négatif que l’aide a sur la bonne gouvernance.
Troisièmement, l’USAID ignore l’impact négatif que l’aide a sur la bonne gouvernance. Ainsi, l’Autorité palestinienne, réalisant qu’elle n’aurait pas de compte à rendre, n’a pas pris la peine de gouverner de manière responsable. Elle a utilisé l’aide occidentale pour financer des meurtres et provoquer des représailles, confiante dans le fait que les donateurs ignoreraient les malversations et reconstruiraient les infrastructures. En coulant à flot, le robinet d’aides a anéanti tous les efforts par lesquels la population soumise à l’Autorité palestinienne pouvait demander des comptes à ses dirigeants.
La Somalie, qui a reçu plus d’un milliard de dollars par an pendant trois décennies, offre un exemple encore plus extrême. La région autonome appelée Somaliland et qui constitue le tiers nord de la Somalie, ne reçoit presque aucune aide car les donateurs internationaux rejettent sa sécession. Pourtant, le niveau de vie et la sécurité du Somaliland dépassent de loin ceux de la Somalie. L’État non reconnu est même devenu le premier pays au monde à assurer l’intégrité des élections grâce à des scans biométriques de l’iris.
Récapitulons. Les couvertures pour les nécessiteux sont peu coûteuses et non controversées. Les bombes pour vaincre des ennemis communs doivent être fournies avec prudence pour ne pas soulever de problèmes d’intérêt personnel et d’aléa moral. La corruption ne doit jamais être décidée par un ambassadeur ou un directeur de projet de l’USAID, mais beaucoup plus haut, de préférence par le Conseil de sécurité nationale, et seulement dans de rares cas, de peur que les pays n’espèrent un paiement au lieu d’une coopération mutuelle.
En somme, l’aide au développement est utile mais, comme toute entreprise de bienfaisance, elle doit être gérée avec le plus grand soin.
Daniel Pipes (DanielPipes.org, @DanielPipes) est le président du Middle East Forum. Michael Rubin est le directeur de l’analyse politique du MEF. © 2025 par les auteurs. Tous droits réservés.