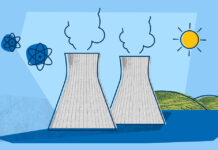Sans réforme en profondeur du système politique et de la structure économique, la Jordanie, comme d’autres pays de la région, restera exposée au potentiel d’une nouvelle révolution, en dépit des milliards injectés par les pétromonarchies du Golfe.
Pendant près d’une semaine, début juin, des images en provenance de la Jordanie ont fait resurgir le souvenir des printemps arabes et du renversement par la rue de plusieurs régimes politiques, rappelant par ailleurs la persistance d’un malaise parmi les populations de la région qui couve encore sous la cendre sept ans plus tard.
Médecins, avocats, enseignants ou entrepreneurs, ils étaient des milliers chaque soir à battre le pavé pour dénoncer un projet de loi fiscale qu’ils considèrent comme injuste. En dépit des appels au calme, la rue n’a pas décoléré, un phénomène inédit depuis les révoltes de 2011, qui avaient secoué dans une timide ampleur le Royaume hachémite sans toutefois mener à la chute de sa monarchie.

Manifestation de la population jordanienne, le 6 juin 2018 | Ahmad Gharabli / AFP
Au coeur de la grogne actuelle: une série de réformes fiscales imposées par le FMI –notamment la levée des subventions et la hausse de l’impôt sur le revenu – ayant propulsé les prix et affaibli le pouvoir d’achat des Jordaniens et Jordaniennes, notamment ceux et celles appartenant à la classe moyenne, qui subissent déjà de plein fouet les retombées économiques du conflit syrien et de l’afflux de quelque 700.000 réfugiés et réfugiées dans le pays.
Augmentation drastique du coût de la vie
Avec une croissance qui peine à dépasser 3% depuis 2011, un taux de chômage à plus de 15% –et à plus de 30% parmi les jeunes– alors qu’un cinquième de la population vit sous le seuil de pauvreté, la hausse répétitive des prix, couronnée par le dernier projet de loi fiscal, ont fini par déclencher une contestation populaire ayant abouti à la démission du Premier ministre.
Depuis janvier, le prix du pain a augmenté, en effet, de 100%, le carburant a été majoré à cinq reprises tandis que les factures d’électricité ont augmenté de 55% depuis février.
Mais ces manifestations –signe d’un changement des temps dans un pays où la tradition démocratique est quasi-inexistante– sont au-delà de la question ponctuelle des réformes fiscales, l’expression d’un malaise plus profond toujours non résolu depuis les printemps arabes, aussi bien en Jordanie qu’ailleurs au Moyen-Orient et en Afrique du nord.
Des réformes sociales trop timides
En sept ans, le roi Abdallah II a procédé à certaines réformes politiques et économiques mais celles-ci sont restées insuffisantes pour enclencher une réelle transition démocratique et développementale, dont le pays, à l’instar de ses pairs arabes, a cruellement besoin. Au niveau politique, une réforme constitutionnelle a ainsi été lancée en septembre 2011, dans la foulée des soulèvements populaires, similaire à celle menée par Mohammed VI au Maroc, afin d’étendre les prérogatives de l’autorité judiciaire, renforcer les pouvoirs du Parlement et créer une cour constitutionnelle. La loi électorale a également été modifiée en juillet 2012. Mais certaines règles du jeu politique, favorables au monarque, sont restées intactes: à titre d’exemple, la désignation du Premier ministre a toujours lieu directement par le roi et non par la majorité parlementaire. Abdallah II a d’ailleurs profité de l’essoufflement du mouvement contestataire à l’échelle régionale à partir de fin 2011 pour tempérer les concessions avancées, même si de nouvelles réformes, comme l’introduction du mode de scrutin proportionnel en 2016, ont eu lieu au cours des dernières années. Mais celles-ci n’ont pas modifié les structures et les fondements du système en place.
Sur le plan économique, le pays s’est également engagé dans une certaine dynamique réformatrice, dont certaines réformes sont néanmoins inspirées du Consensus de Washington et de la pensée libérale que le FMI continue de privilégier aux dépens des considérations socioéconomiques et développementales propres à chaque pays. Ainsi, en contrepartie de plusieurs lignes de crédit accordées par le Fonds, la Jordanie s’est engagée à réduire sa dette, qui culmine à 95% du PIB, via la hausse des impôts et un meilleur ciblage des subventions –des réformes ayant accentué la pression sur la population et provoqué le dernier mouvement de protestation.
En revanche, la lutte proactive contre le chômage, la pauvreté, les inégalités et autres germes du malaise persistant ont été écartées au nom de la «restructuration financière» imposée quasi-systématiquement par le FMI à tous les pays qui lui sont redevables.
Certes le pays a introduit certaines réformes susceptibles de juguler le chômage élevé et de diversifier son économie, mais celles-ci sont restées timides. Ainsi, une loi a été votée en 2014 pour attirer davantage d’investisseurs et inciter à la création de nouvelles entreprises, parallèlement au développement du marché de l’investissement privé (private equity).
Par ailleurs, et sur le plan énergétique, le pays, qui importe 96% de ses besoins, s’est fixé l’objectif, sans doute ambitieux, d’assurer une autonomie totale dans quelques années, en capitalisant sur son potentiel solaire et éolien, mais aussi nucléaire, au lendemain des découvertes ces dernières années de plus de 60.000 tonnes d’uranium dans le centre du pays.
Les aides du Golfe, une perfusion à but politique
Mais le chemin à parcourir reste long pour aboutir à un modèle pérenne. L’économie jordanienne, à l’instar de celle du Maroc, dépend toujours, et dans une large mesure, des aides financières externes, face à un secteur privé encore chétif. Les positions politiques du pays et son alliance avec les États-Unis et l’Arabie Saoudite l’ont jusque-là aidé à se prémunir contre certains risques; dans les années 1990 déjà, la signature d’un accord de paix avec Israël était à l’origine de l’effacement d’une partie de sa dette par l’administration Clinton tandis qu’une série de privatisations vers la fin des années 2000 a également permis de réduire de manière assez sensible le stock de la dette.
Vues sous le prisme du développement durable, ces aides ne peuvent en aucun cas assurer une dynamique pérenne, si elles ne s’accompagnent pas d’un changement en profondeur des structures mêmes de l’économie, permettant de générer de la croissance et de l’emploi, et de réduire ainsi la dépendance et la vulnérabilité économiques.
D’ailleurs, l’un des calmants de la grogne populaire fut une aide de 2,5 milliards de dollars accordés dans l’urgence par trois monarchies pétrolières du Golfe – l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït.
La grogne actuelle en Jordanie n’est pas sans rappeler les manifestations en début d’année en Tunisie, ainsi que le mouvement populaire du Rif déclenché en septembre 2016 au Maroc
Le Qatar, isolé par ses pairs, a quant à lui annoncé la création de 10.000 emplois pour les Jordaniens et Jordaniennes sur son territoire et une aide de 500 millions de dollars à la Jordanie.
Si cette dernière enveloppe est liée à la crise politique dans le Golfe et à la concurrence entre Doha et Riyad, celle des trois autres pétromonarchies est davantage motivée par la crainte d’un effet domino d’une éventuelle instabilité en Jordanie, frontalière de l’Arabie Saoudite.
Le royaume avait déjà bénéficié en 2011 d’une aide de cinq milliards de dollars des pays du Golfe, alors que la région entière était prise dans le tourbillon de la colère de la rue. L’objectif à l’époque était également d’empêcher que le vent révolutionnaire n’atteigne les sables du désert arabique et de protéger des monarchies sunnites siamoises. Les pays du Golfe sont allés jusqu’à proposer au Maroc et à la Jordanie de rejoindre le Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour les protéger davantage –et se prémunir par la même occasion– contre cette vague contagieuse.
Mais pour les pays objet de ces aides, ces perfusions en urgence ne constituent en aucun cas une solution pérenne à leur problème, si ce n’est de repousser à chaque fois l’explosion d’une bombe à retardement.
La grogne actuelle en Jordanie n’est pas sans rappeler les manifestations en début d’année en Tunisie ainsi que le «Hirak chaabi» (mouvement populaire du Rif) déclenché en septembre 2016 au Maroc –tous synonyme d’un printemps inassouvi dont les germes couvent encore.
Ce dont la Jordanie a besoin –aujourd’hui plus que jamais– tout comme les autres pays de la région, est un nouveau contrat social basé essentiellement sur le respect des libertés, l’alternance au pouvoir, l’emploi, la justice sociale et l’éradication d’une corruption endémique. Tant que ces ingrédients d’une stabilisation de longue durée ne sont pas réunis, les mouvements de protestation seront appelés à se renouveler à chaque mesure ou réforme et finir par provoquer un nouveau printemps, similaire, voire plus violent que celui de 2011.
Source www.slate.fr/story