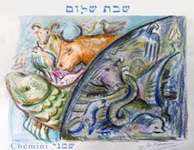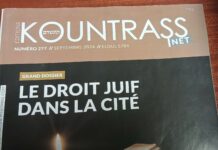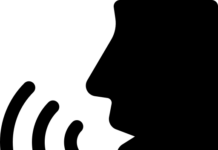Malgré le refus de Téhéran d’engager des discussions directes avec l’administration Trump, le régime iranien ne ferme pas la porte au dialogue. Des pourparlers indirects via le sultanat d’Oman, qui a historiquement servi d’intermédiaire entre les deux pays, sont envisagés. Un haut représentant iranien a expliqué que cette voie permettrait d’évaluer le véritable degré d’engagement des États-Unis envers une issue diplomatique. Toutefois, il reconnaît que le processus s’annonce difficile et incertain.
L’Iran, tout en réaffirmant son opposition aux négociations directes sous la menace, a intensifié ses efforts diplomatiques en alertant plusieurs pays de la région : Irak, Koweït, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn et Turquie. Il leur a été clairement signifié que la mise à disposition de leur espace aérien ou de leur territoire pour une opération militaire américaine ferait d’eux des cibles potentielles. Dans le même temps, les forces armées iraniennes ont été placées en état d’alerte maximale, sur ordre du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.
Le contexte régional, déjà marqué par une instabilité chronique – conflit à Gaza et au Liban, tensions persistantes au Yémen et en Syrie, accrochages militaires entre Israël et l’Iran – amplifie les craintes d’un embrasement généralisé. Le Golfe, zone stratégique par laquelle transite une grande partie du pétrole mondial, est à la fois une artère vitale pour l’économie mondiale et un baril de poudre géopolitique.
Certaines capitales régionales ont tenté de désamorcer la situation. Selon les médias iraniens, le Koweït aurait assuré à Téhéran qu’aucune offensive ne serait autorisée depuis son territoire. Les autres États concernés, tout comme la Turquie, ont gardé le silence ou ont refusé de confirmer les avertissements iraniens, laissant planer un flou stratégique.
La Russie, alliée de poids de l’Iran, a exprimé son rejet des menaces américaines, appelant à la retenue. Toutefois, un responsable iranien confie que Téhéran demeure prudent quant à l’engagement réel de Moscou, dont les priorités pourraient varier au gré des rapports entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
Donald Trump, de son côté, affirme préférer un accord nucléaire à une confrontation armée. Il aurait récemment envoyé une lettre à Khamenei en ce sens. Dans l’hypothèse de négociations indirectes, Oman jouerait encore une fois le rôle de médiateur, avec des diplomates iraniens comme Abbas Araqchi ou Majid Takht-e Ravanchi représentant Téhéran.
Mais la fenêtre pour un accord reste étroite. D’après les sources iraniennes, si rien ne se concrétise dans les deux mois à venir, Israël pourrait décider d’agir unilatéralement, faisant craindre un conflit régional incontrôlable. Une telle attaque précipitée pourrait aussi aboutir à un « snapback » des sanctions internationales, annulant tous les acquis des précédentes négociations sur le nucléaire.
Sur le plan technique, l’Iran continue d’enrichir de l’uranium à un taux élevé, atteignant 60 %, un seuil jugé excessif pour un usage civil par les puissances occidentales. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a mis en garde contre cette progression, qui se rapproche dangereusement des niveaux requis pour une arme nucléaire. L’Iran, pour sa part, nie toute intention militaire et affirme que son programme reste exclusivement civil.
Téhéran se dit néanmoins prêt à discuter de son programme nucléaire, à condition que les négociations ne soient pas imposées sous la menace. En revanche, il exclut catégoriquement toute discussion sur son programme de missiles balistiques, considéré comme un élément non négociable de sa souveraineté et de sa stratégie de défense.
Enfin, un haut commandant des Gardiens de la révolution, Amirali Hajizadeh, a ravivé les tensions en laissant entendre que les bases militaires américaines situées dans la région pourraient être visées en cas d’escalade. Une référence directe à la riposte iranienne de 2020, après l’assassinat du général Qassem Soleimani par les États-Unis, où plusieurs missiles avaient frappé des installations américaines en Irak.
Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives. Entre diplomatie fragile, calculs militaires et risques d’embrasement, la région est suspendue à l’évolution d’un dossier où chaque geste, chaque parole, peut faire basculer l’équilibre.
Jforum.fr