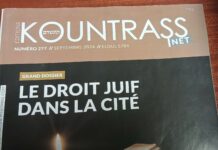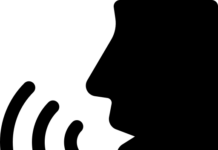Par Reuel Marc Gerecht et Ray Takeyh, National Review
Après 46 ans de régime islamique, l’immobilisme des ayatollahs plonge l’Iran dans la crise. Un changement est-il possible ?
Le mois de février dernier a marqué 46 ans depuis la Révolution islamique en Iran. En général, un tel âge s’accompagne de maturité, de recul et d’un certain renoncement aux illusions de la jeunesse. Mais les islamistes iraniens, eux, semblent éternellement jeunes : accrochés à leurs dogmes idéologiques, incapables d’accepter les leçons de l’Histoire, ils poursuivent sans relâche leur mission de rédemption. L’Iran tout entier est ainsi pris au piège d’un blocage : ses dirigeants ne peuvent changer, mais le peuple, lui, a déjà changé.
En 1979, les ayatollahs promettaient un nouveau gouvernement, alliant foi religieuse, normes démocratiques et prospérité pour la classe moyenne — la classe qui, en son nom, la révolution avait éclaté. Cette révolution se voulait sans frontières : par des activités clandestines et des soulèvements populaires spontanés, les musulmans du monde entier étaient censés embrasser l’Iran islamiste comme messager d’Allah.
La constitution adoptée à l’époque était d’une ingéniosité redoutable : un petit cercle de responsables non élus, dont le Guide suprême et le Conseil des Gardiens, contrôlait l’accès aux fonctions publiques et garantissait que toute nouvelle loi soit conforme à la charia. Mais le système prévoyait aussi des élections pour la présidence, le Parlement et les conseils municipaux — pendant des années, ces scrutins furent bruyants et pluralistes, offrant un semblant de choix réel aux citoyens.
Des figures comme Mohammad Khatami, cinquième président, s’interrogèrent : pourquoi les pays occidentaux réussissent-ils mieux que les nations musulmanes ? Il parlait de « démocratie islamique ». Mahmoud Ahmadinejad, populiste, évoquait la « justice économique ». Hassan Rohani, un révolutionnaire pragmatique, pensait pouvoir sauver l’économie via un accord nucléaire avec les États-Unis.
Ce pluralisme idéologique servait de soupape de sécurité au régime théocratique. Il offrait aux citoyens mécontents une voie légale d’expression politique. Mais tout cela a disparu.
Le responsable principal de cette dégénérescence est le Guide suprême, Ali Khamenei. Il a systématiquement bloqué les initiatives des présidents élus et affaibli le Parlement. Il a vidé les élections de leur substance en imposant que seuls des candidats totalement loyaux puissent se présenter. C’était le cas d’Ebrahim Raïssi, président ultra-conservateur mort l’an passé dans un crash d’hélicoptère, et aujourd’hui de Massoud Pezeshkian, prétendument modéré. Le Parlement, désormais, n’a plus qu’un rôle symbolique, parfois capable de censurer un ministre, mais sans réelle influence.
La majorité des Iraniens ne votent plus, et les institutions censées servir de passerelle entre le peuple et l’élite dirigeante ont perdu toute légitimité. La seule manière qu’ont encore les citoyens pour exprimer leur détresse : descendre dans la rue.
L’ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique, affirmait que le but de la révolution n’était pas lié au prix des fruits sur les marchés. Les religieux n’ont jamais compris l’économie, et leur tentative de concilier libéralisme de marché, redistribution et justice sociale a accouché d’un État-providence inefficace : les soins médicaux sont médiocres, l’enseignement faible, les logements vétustes. Les aides sociales rongent le PIB, et personne n’est satisfait.
Le régime est gangrené par la corruption : les fils de dignitaires religieux raflent les appels d’offres, échappent aux impôts, ne répondent devant aucune loi. Les Gardiens de la Révolution ont pris le contrôle de secteurs clés : communication, construction, banques. Alors qu’un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, les inégalités rappellent les derniers jours d’un royaume décadent. Le tout, pendant que les ayatollahs prêchent chaque jour les vertus du sacrifice pour la patrie et la foi.
Le régime a cependant remporté ses plus grands succès en dehors des frontières. Dès le départ, il visait à déstabiliser ses voisins et à soutenir divers groupes terroristes dont la priorité est la destruction d’Israël. Les États-Unis, qualifiés de « grand Satan », est l’ennemi idéologique suprême. La culture occidentale fascine la jeunesse iranienne, pendant que les navires de guerre américains patrouillent au large des côtes du pays.
Aucune autre nation du Moyen-Orient n’a causé autant de morts américains que l’Iran : attentats contre la base des Marines et l’ambassade à Beyrouth (1983), attaque en Arabie saoudite (1996), embuscades répétées contre les soldats américains en Irak et en Afghanistan. En réponse, Washington a imposé des sanctions économiques dévastatrices.
Mais les ayatollahs ont persisté. Durant les deux premières décennies du XXIe siècle, ils ont bâti un projet impérial plus efficace que tout ce que la région avait vu depuis l’époque britannique : alors que le Moyen-Orient sombrait dans le chaos post-11 septembre et l’échec du Printemps arabe, l’Iran a établi son « axe de la résistance », un réseau d’organisations et de milices chiites fidèles à Téhéran. Elle a contribué au retrait américain d’Irak, harcelé l’Arabie saoudite via ses proxies au Yémen, et maintenu le régime d’Assad à flot en Syrie.
Puis survint le 7 octobre. Jusqu’alors, la stratégie iranienne réussissait en raison du manque de riposte. Les gouvernements américains successifs redoutaient une confrontation directe. Mais Israël a changé les règles du jeu : refusant les appels américains à la retenue, elle a frappé durement le Hamas et le Hezbollah. Peu après, le régime syrien s’est effondré, trop vite pour que l’Iran ou la Russie puissent le sauver. Simultanément, Israël a démontré sa capacité à pénétrer les défenses iraniennes, y compris sur son propre territoire.
Téhéran s’est alors retrouvée vulnérable, avec une influence désormais limitée au Golfe et à l’Irak.
Le peuple iranien n’a pas accepté cette humiliation. Depuis 1979, les soutiens à la révolution se sont érodés. Les libéraux furent les premiers à se désillusionner. Puis les étudiants — moteur historique de la contestation — se sont soulevés dès 1999. Dix ans plus tard, les soupçons de fraude électorale ont donné naissance au mouvement vert, qui a secoué le régime. Une décennie encore, et même les classes populaires sont descendues dans la rue, bien qu’elles soient censées être la base sociale du régime.
En 2023, le mouvement « Femmes, Vie, Liberté » a incarné le profond désespoir iranien. Depuis des siècles, les théologiens musulmans craignent l’influence subversive des femmes. Elles avaient accédé à une certaine reconnaissance lors du court réformisme de Khatami, mais l’élite religieuse a perçu cela comme une menace existentielle. Leur engagement était avant tout un moyen d’exprimer leur rejet du système. Après cette vague de révolte, Khamenei semble considérer les femmes comme irrémédiablement contaminées par l’Occident.
À 85 ans, le Guide suprême s’inquiète sans doute de l’héritage qu’il laissera. Pour l’instant, le bilan est sombre, marqué par l’humiliation subie face à Israël. Le peuple ne cache plus son mépris envers les ayatollahs. La stratégie de défense s’est effondrée, et le régime s’accroche désormais uniquement au programme nucléaire.
Khamenei ne renoncera probablement pas à la bombe atomique, dans laquelle il a investi des dizaines de milliards de dollars. Il espère que l’arme nucléaire consolidera l’influence régionale de l’Iran. Les groupes armés par procuration ne suffisent plus, alors qu’un arsenal nucléaire constituerait un levier dissuasif absolu. Téhéran mise sur le fait que la communauté internationale finira par s’incliner devant une République islamique devenue trop dangereuse pour s’effondrer.
Mais la pourriture interne du régime est si profonde, le rejet populaire si fort, qu’une bombe nucléaire pourrait ne pas suffire à sauver les ayatollahs. À l’inverse, en analysant froidement la situation, Khamenei pourrait bien penser que l’arme nucléaire est son seul espoir de survie pour le régime islamiste.
Article initialement publié sur le site du National Review.