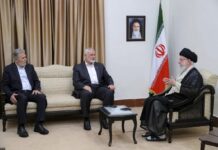Un article de Soulayma MARDAM BEY, publié par l’Orient le Jour
L’Affaire Dreyfus
Par une sinistre soirée de septembre 1894, rue de Lille à Paris, dans les bureaux de l’ambassade d’Allemagne, Marie Bastian vide les poubelles de ses employeurs. Femme de ménage d’une quarantaine d’années, elle travaille en réalité pour les services du contre-espionnage français. Elle leur apporte régulièrement des cornets de papiers puisés au fond de la corbeille de l’attaché militaire prussien Maximilian von Schwartzkoppen. Par cette « voie ordinaire », un bordereau est exhumé, annonçant l’envoi de cinq documents confidentiels. Voilà la preuve qu’un traître manigance au sein de l’armée nationale. Le ministre de la Guerre Auguste Mercier ordonne une enquête. Sur la base d’un dossier fabriqué de toutes pièces et tenu secret, le capitaine Alfred Dreyfus est condamné. L’homme fait figure de coupable parfait : il est juif dans une France gangrenée par le nationalisme et l’antisémitisme. Bien qu’il ne cesse de clamer son innocence, il est dégradé avant d’être envoyé au bagne sur l’île du Diable, au large de la Guyane. Il ne sera réhabilité qu’en 1906.
Des intellectuels de l’Empire ottoman prennent la défense du Capitaine
De l’autre côté de la Méditerranée, des penseurs d’horizons divers observent avec intérêt le déroulement de cette affaire. Car, depuis l’engagement public, en 1898, du romancier Émile Zola en faveur du capitaine déchu, le scandale connaît un retentissement mondial. Face à l’obsession antijuive d’une partie des élites françaises, des intellectuels d’un Empire ottoman crépusculaire prennent fait et cause pour l’accusé. À commencer par l’un des précurseurs du fondamentalisme islamique, Rachid Rida, qui se distingue alors en Égypte par un vibrant plaidoyer en sa faveur. Comptant parmi les pionniers du modernisme laïque, Farah Antun salue pour sa part en 1899, dans le magazine al-Jami’a, le courage des défenseurs du condamné. Quant à Esther Moyal, militante des droits des femmes et journaliste libanaise de confession juive, elle consacre à Émile Zola une biographie en 1903.
Des « cousins orientaux »
Mais les passions françaises ne tourmentent pas que les esprits ouverts. L’époque est alors marquée par l’influence européenne. Les interactions culturelles se multiplient, amenant certains à côtoyer des antisémites notoires. Il en va ainsi de Négib Azoury, chrétien maronite et nationaliste arabe, qui fera la rencontre en France, où il s’est exilé en 1904, de l’écrivain Maurice Barrès, figure de proue du nationalisme français. « Négib Azoury s’alliera aux militants antidreyfusards, connus pour leur antisémitisme radical », rappelle Malik Bezouh, auteur de ‘Je vais dire à tout le monde que tu es juif’ (éd. Jourdan, 2021). Une tendance qui reste toutefois marginale. « Quand l’antisémitisme européen commence à atteindre une forte visibilité, notamment avec l’affaire Dreyfus, ceux qui pouvaient suivre ces événements exprimaient le plus souvent des sympathies pour les Juifs, ces derniers étant perçus comme des “cousins orientaux” au sein de l’espace chrétien occidental », résume Gilbert Achcar, professeur de relations internationales à la School of Oriental and African Studies (SOAS) de l’Université de Londres.
La construction d’une prétendue « race sémitique »
Une solidarité transméditerranéenne qui semble renforcée par le développement, tout au long du XIXe siècle, de théories raciales dans une Europe en voie de sécularisation, où l’antijudaïsme religieux mute vers un antisémitisme biologique. L’historien Reza Zia-Ebrahimi souligne, dans son ouvrage Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée (éd. Amsterdam 2021), la construction d’une prétendue « race sémitique », censée comprendre « les Juifs, les Arabes (de toutes religions) » ainsi que d’autres peuples anciens, « racialisés en raison de leur proximité linguistique supposée ». Une association qui évoque le souvenir de la « Reconquista » espagnole menée par les rois catholiques et s’achevant par l’expulsion successive des Juifs (1492) et des musulmans (1502), qui se réfugient ensemble dans l’espace allant de l’Afrique du Nord à la Turquie.
« Ce qui va changer les choses, c’est le début de la réalisation du projet sioniste »
À bien des égards, l’affaire Dreyfus marque un tournant qu’illustrent nombre de trajectoires. Côté européen, c’est en suivant de près les événements qui agitent la France que le journaliste viennois Theodor Herzl (1860-1904) – père fondateur du sionisme politique – commence à concevoir l’idée d’un État juif, convaincu que ses coreligionnaires ne seront jamais en sécurité, qu’ils soient parfaitement assimilés, à l’instar du capitaine, ou non. C’est aussi cette même injustice qui conduit un anarchiste français tel que Bernard Lazare, autrefois partisan acharné de l’assimilation, à porter son regard vers la Palestine et à devenir, à la fin du XIXe siècle, l’un des rares sionistes originaires d’Europe de l’Ouest. Côté arabe, ce sont a contrario les balbutiements du sionisme qui mènent des intellectuels jadis solidaires des Juifs européens à se référer progressivement aux théories antisémites nées en Europe. C’est le cas par exemple de Rachid Rida, né comme Bernard Lazare en 1865, qui mêlera alors ces thèses importées à des versets du Coran hostiles aux Juifs. « Ce qui va changer les choses, c’est le début de réalisation du projet sioniste après la déclaration Balfour en 1917, le départ des Britanniques aux commandes en Palestine et la porte ouverte à l’immigration juive sous le contrôle de l’Agence juive , insiste Gilbert Achcar. Mais cela ne veut pas dire que le basculement vers l’antisémitisme s’est fait automatiquement et pour tout le monde. Il y a d’abord une distinction qui s’opère entre Juifs européens et orientaux, puisqu’il y avait de grandes communautés juives dans le monde arabe, dont beaucoup de communistes et même de nationalistes arabes qui percevaient le sionisme comme une entreprise coloniale européenne. »
Dhimmis
De fait, l’histoire juive depuis la conquête musulmane jusqu’à la chute de l’Empire ottoman s’insère dans un système de discriminations, mais aussi d’échanges culturels et sociaux. Les Juifs, tout comme les chrétiens, sont soumis à la dhimma qui confère aux « gens du Livre » un statut social inférieur – donc inégal et humiliant –, tout en garantissant la protection de leur vie et de leurs biens. En pratique, la dhimma n’a toutefois jamais été appliquée dans son intégralité, interprétée aux heures fastes de manière éclairée ; aux heures sombres de manière crispée. Inconcevable aujourd’hui, la lecture en vogue parmi les intellectuels juifs européens du XIXe siècle – mise en lumière par l’historien Mark Cohen – proposait alors un récit idéalisé de la coexistence judéo-musulmane au Moyen Âge, par opposition à un univers occidental chrétien où les persécutions ont été systématiques. « Pour les chrétiens – pour une partie d’entre eux –, les Juifs vont être à l’époque considérés comme le peuple déicide. Cela ne sera jamais pardonné, et cette idée va se diffuser au Moyen Âge dans l’inconscient collectif, explique Malik Bezouh.
La rumeur du meurtre rituel
En terre d’islam, en revanche, les Juifs n’ont pas pu mettre Jésus sur la croix, car celui qui est mort sur la croix, selon la théologie musulmane, ressemble à Jésus, mais n’est pas Jésus. » Derrière ce comportement relativement plus clément, l’absence, entre autres, d’un antijudaïsme conspiratoire. « La croyance du meurtre rituel pratiqué lors de la Pessa’h juive n’existe pas en terre d’islam, tout comme la croyance selon laquelle les Juifs seraient à l’origine de la peste », analyse Malik Bezouh. Une référence au mythe particulièrement tenace au Moyen Âge imputant aux Juifs l’égorgement pour la Pâque d’enfants non-juifs dont ils utiliseraient le sang pour faire du pain azyme. Or, cette rumeur ne se répand véritablement en Orient qu’à partir de 1840, dans le sillage de la disparition à Damas d’un moine capucin et de son domestique. L’enquête sur l’affaire est alors confiée à la France, responsable de la protection des chrétiens de l’Empire ottoman. La monarchie de Juillet est représentée par le consul Benoit-Ulysse de Ratti-Menton, obnubilé par ce fantasme.
Le décret Crémieux a des effets secondaires
Petit à petit, la politique des minorités forme le contrefort de l’architecture coloniale. Et dans ce nouveau monde, les Juifs sont placés dans une position ambivalente. « Alors qu’en Europe, même le Juif assimilé était soumis à la racialisation post-Lumières, en Orient, le Juif indigène entrait dans un processus de “blanchissement” symbolique, mais seulement par rapport aux indigènes musulmans », résume Ella Shohat, spécialiste des études juives arabes, dans la préface de Colonialité et rupture (éd. Lux éditeur, 2021). Emblématique de ce système, la politique algérienne de la France, qui, à travers le décret Crémieux (1870), accordera la citoyenneté française de manière automatique aux « indigènes » juifs, excluant en revanche de la communauté nationale les musulmans. Une hiérarchisation qui alimente les frustrations, culminant au cours de l’été 1934 par les émeutes antijuives de Constantine. Un déferlement de haine dans un contexte délétère de campagne municipale. Pour nombre de colons, hors de question que des Juifs participent à la gestion de la ville. Et pour les rebuter, ils n’hésitent pas à les jeter en pâture à une population musulmane qui se sent lésée. L’épisode est sanglant. Il fait 24 morts côté juif et 3 côté musulman. Le tout sous le regard passif de l’armée. Une violence qui souligne la précarité du statut des Juifs, pris en tenaille entre la rancœur d’une population musulmane discriminée et l’antisémitisme des colons. En atteste la publication dès le lendemain d’un article du venimeux Tam-Tam, journal populaire parmi les Européens, affirmant sans ambages : « 90 % d’entre nous, tout en regrettant le sang versé, ne le blâment pas, et beaucoup d’entre nous ne feront rien pour empêcher le retour de ces choses. »
1948, l’Indépendance d’Israël perçue comme une catastrophe
Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) puis de la création d’Israël (1948), la séparation entre Juifs et musulmans s’accélère. La monstruosité de la Shoah et le traumatisme des survivants nourrissent indéniablement de nouvelles affinités pour le sionisme, rejeté auparavant par une grande partie des Juifs européens. L’entreprise industrielle d’anéantissement des Juifs d’Europe par le IIIe Reich crée en outre sur le continent un fort sentiment de compassion mêlé de culpabilité. Une nouvelle conviction voit le jour : pour qu’une telle tragédie ne puisse pas se reproduire, les Juifs doivent avoir un État à eux. Dans le monde arabe en revanche, la naissance d’Israël est assimilée à une catastrophe, la conclusion d’une étape et l’amorce d’un projet qui n’aurait pu s’étendre sans la dépossession systématique de la population autochtone, sans l’expulsion des Palestiniens, sans d’innombrables massacres. Un processus colonial théorisé en Europe, mis en œuvre par des Européens et dont la temporalité déstabilise d’autant plus qu’elle se déploie, alors dans le contexte régional des luttes indépendantistes.
« Les Juifs arabes ont été les secondes victimes du sionisme »
Dans ces circonstances, les Juifs arabes doivent progressivement faire face au mariage de deux identités jugées antinomiques par le nouvel État d’abord, par les régimes arabes ensuite. Presque partout, ils composent avec une suspicion généralisée, deviennent la cible d’attaques, parfois d’envergure, contre leurs personnes et leurs biens. Peu à peu, l’histoire de la cohabitation séculaire est écrasée par la guerre des récits liée au conflit israélo-arabe dont l’une des plus graves conséquences est la déjudaïsation de la région. « Les Juifs arabes ont été les secondes victimes du sionisme. La plupart des Juifs marocains sont partis en Israël parce qu’on est venu les chercher pour venir remplacer les Palestiniens qu’on venait de chasser et former une majorité juive », indique la documentariste franco-marocaine Simone Bitton, dont le dernier film, Ziyara (2021), donne la parole aux gardiens musulmans de la mémoire juive au Maroc. Dans les années cinquante, environ 300 000 Juifs y vivaient. Aujourd’hui, ils sont 3 000 tout au plus. La cinéaste dénonce également des États arabes coupables d’avoir alimenté la suspicion autour de leurs ressortissants de confession juive en entretenant, de manière plus ou moins explicite, à l’instar d’Israël, la confusion entre « sionistes » et « Juifs ».
Départs sans retour
En Irak, la naissance du nouvel État fragilise davantage une communauté coincée entre les manœuvres de l’organisation sioniste pour l’arracher à sa terre et l’intensification des discriminations dont elle fait l’objet chez elle. En septembre 1948, l’homme d’affaires Chafik Adas est publiquement pendu à Bassora après avoir été accusé sans preuve de conspirer pour les sionistes… et les communistes. Surtout, une loi est votée en 1950, permettant aux Juifs qui le souhaitent de quitter le territoire à condition de rendre leur nationalité. Le but ? Assurer un départ sans possibilité de retour. En Égypte, l’agression tripartite de Suez, menée en 1956 par Israël, la France et l’Angleterre, a des retombées effroyables pour la communauté locale, élevée par les autorités au rang d’ennemie de l’État. « Dans certains pays, les nationalistes arabes ont eux-mêmes chassé les Juifs, c’est-à-dire qu’ils ont finalement eux-mêmes fait œuvre de sionisme. Cela est impardonnable, insiste Simone Bitton. Quand les Juifs arabes sont arrivés en Israël, les Palestiniens étaient déjà dans des camps de réfugiés. Ce ne sont pas eux qui ont construit l’État. »
Poussés au départ, nombre de Juifs entament alors leur exode. Un déracinement pensé et voulu par Israël que ce dernier érigera néanmoins en ultime symbole de leur histoire dans la région. Objectifs : établir un parallèle entre l’exil des Palestiniens et celui des Juifs pour mieux minimiser le drame des premiers ; fondre le passé judéo-arabe dans l’expérience juive européenne, jusqu’à accréditer la thèse d’une responsabilité palestinienne dans la Shoah. Caractéristique de cet effacement, la campagne visant à inclure au mémorial de l’Holocauste les « farhoud », ces émeutes meurtrières qui ciblent la communauté de Bagdad à l’orée du mois de juin 1941. Déclenchées après des semaines d’épouvantable propagande antisémite instiguée par les nationalistes arabes pro-allemands, elles prennent place dans le sillage de leur coup d’État contre la monarchie, elle-même proche de Londres. « Quand il arrive que l’historiographie sioniste s’intéresse à l’histoire judéo-islamique, cela se réduit au jeu morbide et sélectif, qui consiste à “relier les points” d’un pogrom à l’autre », écrit Ella Shohat, rappelant que ce dernier terme renvoie d’abord à l’expérience des Juifs d’Europe de l’Est.
Le Mufti de Jérusalem
Dans le même esprit, une partie de la rhétorique sioniste confère un poids mensonger au leadership palestinien durant la Seconde Guerre mondiale. Au centre de ce discours, la figure du mufti de Jérusalem, hajj Amine el-Husseini, dirigeant du mouvement national palestinien jusqu’en 1941. Publiée en association avec le Mémorial de Yad Vashem, l’encyclopédie de l’Holocauste, signale Gilbert Achcar, va jusqu’à lui accorder plus de place qu’à des piliers du régime nazi tels que Himmler ou Goebbels. Une tendance portée à son paroxysme par l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui prétend au cours du Congrès sioniste mondial en 2015, que le mufti aurait insufflé l’idée de la solution finale à Hitler… Certes, l’homme a incontestablement été un collaborateur actif des puissances de l’Axe dont il est devenu le porte-parole non seulement vis-à-vis du monde arabe, mais aussi auprès de l’ensemble du monde musulman. Il a même contribué à la mise sur pied d’une division SS musulmane en Bosnie. Néanmoins, la focalisation sur ce personnage passe sous silence la pluralité des attitudes arabes face au IIIe Reich.
Quatre courants idéologiques
Une diversité idéologique soulignée par Gilbert Achcar dans son ouvrage Les Arabes et la Shoah (éd. Actes Sud, 2009), dans lequel il distingue quatre courants principaux. Libéraux occidentalistes d’une part et marxistes de l’autre se sont résolument opposés au nazisme. Ils seront cependant désavoués après la Nakba palestinienne en 1948, du fait de l’appui de leurs parrains respectifs, Londres et Moscou, à la création de l’État d’Israël. Du côté des nationalistes, certains se méfient de Berlin à cause de son alliance avec Rome, puissance coloniale en Libye. D’autres y voient « l’ennemi de l’ennemi » britannique ou français. Une frange parmi eux développe en Irak et en Syrie une proximité à la fois stratégique et idéologique, à l’instar du Parti syrien national social (PSNS). Enfin, le panislamisme intégriste, dont Amine el-Husseini est l’illustre représentant, se distingue globalement par un antisémitisme virulent et un soutien sans réserve aux forces de l’Axe. Mais ses appels à rejoindre Hitler n’auront pas l’écho escompté. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, seuls 6 300 hommes issus du Maghreb et du Moyen-Orient sont passés par les différentes organisations militaires allemandes. C’est peu comparé aux 9 000 Palestiniens qui ont combattu dans les rangs de l’armée britannique et des centaines de milliers de Maghrébins qui en ont fait de même auprès de la France libre.
Le Protocole des Sages de Sion devenu très populaire
Si l’histoire le conteste, le préjugé selon lequel « Juifs » et « Arabes » seraient voués à se haïr est toutefois non seulement conforté par la réécriture sioniste du passé, mais aussi par l’importation effective dans la région, au cours du XXe siècle, d’un antisémitisme d’origine européenne fondé sur le complotisme et le négationnisme. Le premier est notamment incarné par la popularité des Protocoles des Sages de Sion, ce faux d’origine inconnue, apparu en Russie au début du siècle dernier. Largement diffusé dans l’Europe de l’entre-deux guerres, il postule l’existence d’une conspiration juive pour dominer le monde. Traduit en 1921, il bénéficie graduellement d’un écho favorable dans des cercles arabes nationalistes et islamistes, sur fond d’accroissement des tensions avec le mouvement sioniste en Palestine. Mentionné dans la Charte du Hamas de 1988 (mais retiré dans le document amendé en 2017), il est même adapté à l’orée des années 2000 en une série télévisée égyptienne – Le Cavalier sans monture – reprise ensuite par la chaîne du Hezbollah al-Manar.
Colère, ressentiment, haine et djihadisme
Quant au négationnisme, il relève jusque dans les années 1980 d’un phénomène négligeable mais gagne en audience à mesure que s’intensifie le conflit israélo-palestinien, dans un contexte mondial de recul des idéologies progressistes. Face à l’utilisation politique du génocide nazi par les autorités israéliennes, à laquelle se combine la non-reconnaissance de la Nakba, les ouvrages de négationnistes occidentaux, comme Robert Faurisson ou encore Roger Garaudy, trouvent une oreille attentive auprès de certains médias arabes. Plus généralement, ainsi que le souligne Malik Bezouh, « la blessure de la dépossession va susciter colère et ressentiment qui s’illustrent notamment par des écrits antijuifs très violents. Cette hostilité déviera vers un antisémitisme hybride, empruntant à l’antisémitisme classique européen et à l’antijudaïsme d’essence islamique ». Une haine qui puise dans l’avènement du jihadisme à partir des années 1970 un puissant moyen de transmission, sur fond de rejet de l’Occident.
Des dinosaures en voie de disparition
Y a-t-il encore une place dans la mémoire d’un monde arabe en miettes pour la part juive de son identité ? Se souviendra-t-on demain qu’il y eût un jour une judaïté arabe ? « Le juif arabe est une espèce en voie de disparition, rares sont ceux qui, comme moi, continuent de se considérer comme tels. Au fur et à mesure que mes aînés disparaissent, j’ai parfois l’impression d’être un dinosaure. Dans cinquante ans, nous n’existerons plus », dit Simone Bitton. « Notre identité a été engloutie, mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas d’histoire. Et notre histoire étant partagée, il faut absolument la connaître pour nos descendants et pour ceux des autres Arabes. »
Jforum – L’Orient Le Jour