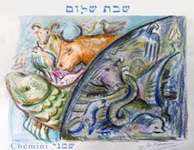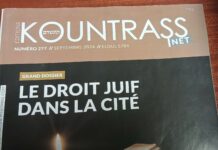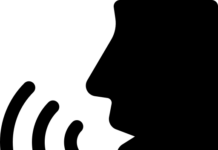Le débat de la Cour suprême sur le limogeage du chef du Shin Bet risque de saper la structure du pouvoir en Israël et d’affaiblir la supervision nécessaire d’un service de renseignement dans un État démocratique.
Ynet – Shaul Scharf
Lors de l’audience sur la révocation du chef du Shin Bet, les juges de la Cour suprême ont commis deux erreurs. La première est juridique. La loi sur le Shin Bet stipule explicitement que le gouvernement a le pouvoir de démettre le chef du service. Certes, les principes fondamentaux du droit public s’appliquent à toute décision gouvernementale, y compris un licenciement, et en apparence, le débat portait sur les défauts de la procédure de révocation – un domaine relevant bien de la Cour. Mais en réalité, comme on peut le lire entre les lignes des requérants, leur intention était de contester la compétence claire que la loi confère au gouvernement sur le Shin Bet. Si les juges avaient été attentifs à la manœuvre des requérants, qui ont dissimulé une attaque contre la compétence derrière des critiques procédurales, ils auraient dû rejeter la requête d’emblée, en rappelant que priver le gouvernement de son autorité sur le Shin Bet et son chef va à l’encontre de la loi et de la logique démocratique.
Le second plan est institutionnel – et il est plus important ici. Le débat sur la subordination du Shin Bet au pouvoir exécutif ne remet pas seulement en cause l’architecture militaire de l’État, il ignore aussi la nature et la dynamique d’un organisme comme le Shin Bet. Apparemment, les juges de la Cour suprême ne voient pas de problème à l’érosion de l’autorité du gouvernement sur le Shin Bet, peut-être dans l’espoir que ce dernier se place sous l’autorité judiciaire. On pourrait même affirmer que les juges envoient un signal au chef actuel du Shin Bet – et à ses successeurs – sur qui est le « patron » dans cette lutte de pouvoirs. C’est une erreur grave et dangereuse.
La loi sur le Shin Bet n’est pas née d’un caprice politique. Elle est le fruit d’un long processus par lequel Israël a cherché à renforcer la stabilité de son régime et à ancrer l’idée de gouvernance étatique dans sa structure de pouvoir. Dès 1948, Ben Gourion a démantelé les milices armées dans des démarches douloureuses – comme l’affaire de l’Altalena ou la dissolution de l’état-major du Palmach. Plus tard, en 1975, à la suite de la guerre de Kippour, une loi fondamentale a été adoptée : « L’armée est subordonnée au gouvernement. » Enfin, en 2002, après les années 1990 tumultueuses, la loi sur le Shin Bet a été adoptée, inscrivant noir sur blanc que « le service est subordonné au gouvernement ». Ce n’est pas un hasard si la loi place le Shin Bet sous autorité gouvernementale. Un organisme secret doté d’un immense pouvoir militaire et de renseignement est fortement tenté d’agir selon ses propres intérêts.
Le gouvernement, en tant que détenteur du pouvoir d’État, dispose des outils pour guider l’action du Shin Bet de manière efficace tout en limitant ses actions pour qu’elles soient conformes à l’intérêt national (selon les termes de la loi). Néanmoins, il faut admettre que même cette subordination n’est pas une garantie absolue. L’histoire du contrôle du Shin Bet montre qu’une simple dépendance au gouvernement ne suffit pas pour assurer une gouvernance responsable. Il faut donc trouver un équilibre entre subordination et supervision externe, sans pour autant transformer la Cour en autorité décisionnelle – car elle peut aussi souffrir d’aveuglement politique et institutionnel.
La gouvernance étatique n’est pas une valeur abstraite. Rompre l’équilibre fixé par la loi, affaiblir l’autorité du gouvernement sur le Shin Bet et son chef, est une menace grave pour le tissu institutionnel israélien. Libérer le Shin Bet du contrôle gouvernemental revient à le libérer de toute retenue, critique ou surveillance. Bien entendu, il convient de distinguer entre une subordination totale au gouvernement et un contrôle judiciaire des procédures, comme cela se fait dans les pays démocratiques.
Le Dr Shaul Scharf (notre photo) est maître de conférences en droit au Centre académique Peres à Re’hovoth et rédacteur en chef de la revue Rechout Harabim du Forum israélien pour le droit et la liberté.