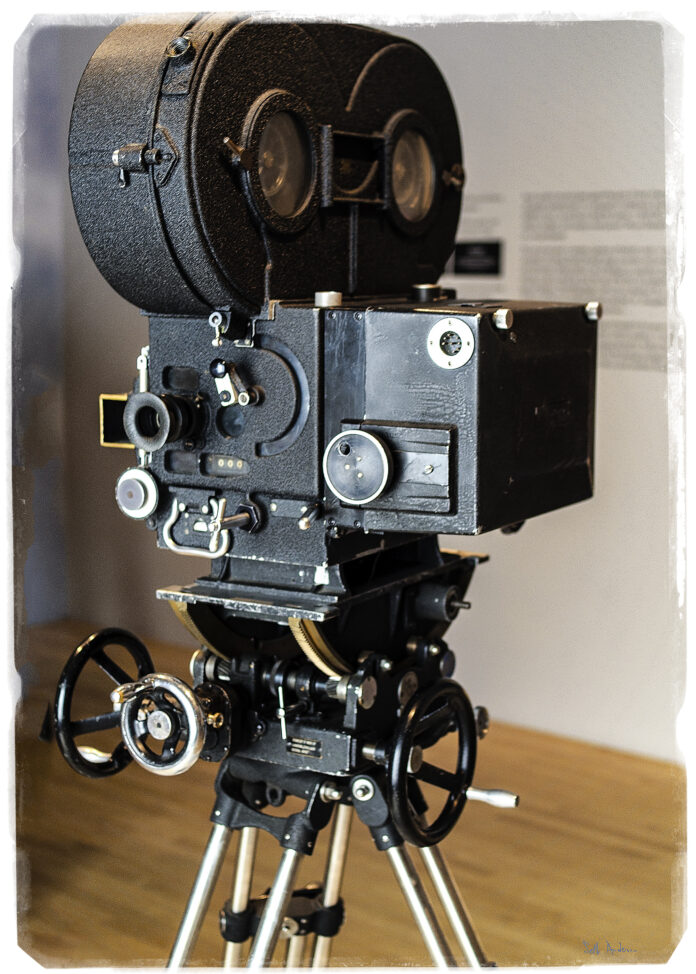En filmant eux-mêmes leurs crimes, les terroristes du Hamas ont assuré la mise en spectacle du massacre qu’ils ont commis le 7 octobre. Un film de plus de 40 minutes, documentant les atrocités, a été conçu par les autorités israéliennes et plusieurs fois projeté (depuis le 23 octobre en Israël, depuis le 14 novembre en France) devant un public choisi. Que contient exactement ce film – qui soulève la difficile question de savoir comment manier ces images ? Dans un débat réalisé en partenariat avec Akadem, Michael Prazan (documentariste et écrivain) et Jean-Baptiste Thoret (historien du cinéma) interrogent l’histoire, les usages, et les effets des images documentaires de violence extrême sur ceux qui les regardent.
Stéphane Bou : La question de la représentation des images de violence et d’atrocités est une vieille question, à la fois esthétique et politique, mais qui doit sans doute être reprise à nouveaux frais avec le terrorisme moderne. Commençons par revenir sur l’histoire précise – probablement, au moins depuis le 11 septembre – de l’introduction des images du crime comme une des armes des criminels eux-mêmes, décidant de les enregistrer et de les propager.
Michael Prazan : J’aborderai cette histoire à partir de trois motifs : la jouissance, le trophée et le recrutement. Si je mets de côté pour le moment le recrutement, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, restent la jouissance et le trophée. Je remonterais alors jusqu’aux Einsatzgruppen, c’est-à-dire la première phase du génocide des Juifs entrepris par Hitler et l’Allemagne nazie.
Immédiatement, dès que les premiers massacres de Juifs commencent, Hitler réclame de les voir. Des opérateurs photographiques ou filmiques sont envoyés pour les documenter, dont les images seront ajoutées au rapport quotidien des Einsatzgruppen donné au RSHA, c’est-à-dire à Berlin. Hitler est avide de voir comment se déroulent ces exécutions de masse. Et il est intéressant de rappeler ici que dans la première séquence de cette phase du génocide – au début de l’été 41 – ces massacres ont lieu à ciel ouvert, comme un spectacle pour les locaux qui y assistent. Après, les nazis vont essayer de réduire le nombre de témoins. Ils vont à la fois fermer au « public », si je puis dire, le « spectacle » de ces massacres et interdire aux exécutants de prendre des photos. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que des opérateurs professionnels prendront le relais pour documenter ce qui se passe.
La question du trophée et de la jouissance vient à partir de ce moment où l’enregistrement des massacres est interdit aux exécutants. En fait, les prises de photos ne peuvent pas être contrôlées. Beaucoup d’exécutants sont équipés du petit appareil photo Leica et, non seulement ils prennent, indépendamment des directives de Goering ou du RSHA, des photographies pour eux-mêmes, mais ils les collectionnent et se les échangent entre eux. Le même phénomène avait eu lieu lors du massacre de Nankin perpétré par les Japonais dans l’ancienne capitale de Chine, quand des soldats s’échangeaient des photos d’exactions, de massacres, de décapitations qu’ils avaient prises eux-mêmes. Tout cela fonctionne en interne et on ne diffuse pas ces images au grand public. De sorte que, pour revenir sur la question des massacres des Einsatzgruppen, lorsque l’Allemagne nazie perd la guerre, qu’il y a des bombardements sur Berlin, et qu’il faut détruire les preuves, la première chose que les nazis vont faire, c’est de détruire les images qu’ils avaient en leur possession. Toutes ne seront pas détruites, mais presque. Cependant, ils n’auront pas moyen d’agir sur les images qui ont été prises par les soldats eux-mêmes…
Il faut rappeler ici qu’au cours de la Shoah, est venu le moment où a été édicté officiellement que le crime devait avoir lieu dans le secret absolu. Ce que marque la fameuse phrase de Himmler, prononcée lors du discours de Posen en octobre 1943, quand il dit que l’extermination des Juifs est une « page de notre histoire qui ne sera jamais écrite » et évoque un « secret » qu’il faudra que les assassins emportent dans leurs tombes.
MP : Oui, mais il y a tout de même, encore une fois, jusqu’à la fin de cette première phase du génocide, des opérateurs professionnels dépêchés par le RSHA, qui continuent d’aller sur le terrain pour filmer et photographier. Il est clair que les crimes de masse ont été documentés. Par exemple, le massacre de Babi Yar, où 33 771 Juifs ont été assassinés en deux jours à Kiev, a été filmé et très certainement aussi photographié. Seulement, on n’a plus aujourd’hui les traces de ces enregistrements. Ce sont les exécutants qui, eux, sans en avoir la permission, ne se retiennent pas de prendre des images, comme des trophées et des objets de jouissance. À ce moment-là, il n’y a pas la volonté, avec ces images, de recruter de nouveaux nazis ou de nouveaux assassins. Mais c’est ce phénomène de recrutement par les images qui va se développer au cours de l’histoire du terrorisme.
C’est un phénomène qui commence à quel moment ?
MP : Je remonterai assez loin dans le temps. À mon avis, l’un des événements déterminants de cette histoire-là a lieu quand, en 1971, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), détourne trois avions de ligne qu’il fait exploser. Ils vont filmer ces explosions. Il n’y a pas eu de morts. Les passagers avaient été évacués des avions avant que ceux-ci n’explosent. Reste que ces images vont fortement impressionner des militants radicaux du monde entier qui vont, grâce à cette publicité, vouloir rejoindre la lutte des Palestiniens, laquelle n’est pas encore dans sa phase islamiste.
Et puis vient le 11 septembre…
MP : Encore faut-il préciser que le 11 septembre, ce ne sont pas les terroristes eux-mêmes qui filment leur opération spectaculaire. L’attentat se déroule au cœur d’une nouvelle époque, qui a changé, et où l’image est devenue dominante : l’événement est donc filmé en direct par un certain nombre de caméras privées ou par la télévision. Ces images très spectaculaires vont faire le tour du monde et vont permettre à la fois de publiciser une opération, une marque – Al-Qaïda en l’occurrence – et de produire un phénomène de recrutement en faveur des organisations terroristes. Mais le vrai basculement – et on entre là dans une autre humanité, si je puis dire – c’est l’assassinat de Daniel Pearl, le journaliste américain à Karachi, toujours par Al-Qaïda, ou une filiale d’Al-Qaïda, qui est égorgé devant une caméra qui enregistre et diffuse en direct son assassinat. Les nazis ne voulaient pas communiquer sur les exécutions qu’ils filmaient ou qu’ils photographiaient de peur que l’on s’identifie à la victime. Le vrai basculement, à partir de l’assassinat de Daniel Pearl, consiste à produire par l’image une identification au bourreau, dans l’objectif de recruter. C’est vraiment un retournement de paradigme. Daesh notamment, va filmer les pires exactions et produire des images qui nous répugnent et nous tétanisent, mais qui, sur des gens déjà radicalisés ou en voie de radicalisation, produisent l’effet inverse, la jouissance et l’exaltation. L’identification avec le bourreau, et non plus avec la victime, que ces images encouragent, va accélérer le recrutement. L’intention du filmage des massacres du 7 octobre s’intègre aussi dans cette logique. Et d’ailleurs, je crois savoir que ces images ont produit ce même effet : il y a des gens qui, après avoir vu ces images, ont cherché à rejoindre le Hamas…
Jean-Baptiste Thoret, comment décririez-vous la situation du spectateur moyen qui, installé derrière ses multiples écrans, se trouve confronté à ces images d’atrocités qui finissent par faire effraction dans son flux d’images et d’informations quotidien ? Quel effet a leur mise en circulation pour tout le monde ?
Jean-Baptiste Thoret : Je pense qu’il faut prendre la mesure de ce qui s’est passé au niveau des images du 11 septembre, et qui continue d’interroger notre actualité. Souvenons-nous des commentaires de l’époque, qui disaient que les terroristes avaient utilisé un modus operandi, un certain canevas d’images préexistantes, plébiscitées par l’Occident, par Hollywood. Autrement dit, les terroristes s’étaient servis de codes esthétiques et cinématographiques dont nous avons l’habitude, en tant que spectateurs, pour y introduire la réalité d’un événement meurtrier. Lorsque l’on voit les avions qui arrivent sur les tours du World Trade Center, qui finissent par s’écrouler, il y a un moment de flottement ou d’indécision. On a le sentiment de voir quelque chose que l’on a déjà vu…
Comme si dans le réel survenait quelque chose qui avait déjà été vu dans les films-catastrophes ?
JBT : Voilà. Il y a cette qualité que l’on prête au cinéma hollywoodien quand on dit – ce qui s’est beaucoup dit à l’époque – qu’il avait déjà fabriqué ces images-là. Tout est apparu comme si le 11 septembre 2001 était, d’une certaine manière, un remake d’images et de films qui avaient déjà été faits. D’où le sentiment à la fois de stupéfaction – on n’a jamais vu ça – et celui de redite – on a déjà vu ça cent fois. Il faut aussi rappeler qu’à l’époque, les médias américains ont le contrôle de ces images-là. Et ils vont rediffuser en boucle et partout l’effondrement des tours. Ce ne sont pas des images filmées par Al-Qaïda, mais les terroristes peuvent en profiter. À la manière d’un cheval de Troie, les images de leurs attentats viennent se lover dans une machine médiatique surpuissante, la machine médiatique occidentale, et la font dérailler. Ou plutôt, il faut se demander si ces images font dérailler la machine, ou si elles la poussent jusqu’à un point où apparaît son propre refoulé ? Je crois pour ma part que ce qui fait justement toute l’ambiguïté de ces images, c’est qu’elles vont au bout d’une fascination qui hante les images occidentales contemporaines : celle de filmer le meurtre. Normalement, cette fascination se heurte à un interdit, mais ces images viennent le transgresser. Ce qui soulève alors une question, exacerbée dès lors que les images commencent à être produites par les terroristes eux-mêmes : qu’est-ce qui doit être montré ? Car les médias peuvent choisir de diffuser ou de ne pas diffuser. Les images de l’assassinat de Daniel Pearl sont à cet égard exemplaires, car l’émetteur n’est plus le même : les terroristes produisent une vidéo où tout est montré, l’intention, l’exécution et le résultat. Que font les médias occidentaux à ce moment-là ? Ils décident de commencer à censurer. Tout ne va pas être montré. On voit le bourreau se préparer à faire l’acte et, à l’instant où il va avoir lieu, la diffusion est arrêtée. Ce que l’Occident ne peut pas montrer, c’est l’exécution.
MP : La grande différence qu’il y a entre le 11 septembre 2001 et Daesh, ou le Hamas aujourd’hui, c’est en effet la question de la diffusion. Lors des attentats du 11 septembre, les terroristes ne maîtrisent pas la diffusion et c’est pour cela que, d’une certaine manière, ils l’ont confié aux chaînes de télévision ou à quiconque pouvait filmer l’événement. Ce qui va évidemment totalement changer la donne, ce sont les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, n’importe qui peut diffuser. On peut désormais filmer un assassinat avec une GoPro et, quasiment en temps réel, diffuser partout dans le monde les images. Et ça, cela va évidemment multiplier les visionnages possibles, par n’importe qui ,d’images de massacre « faites maison ».
Ce qui a été le cas le 7 octobre puisque des images ont circulé immédiatement sur les réseaux au moment même où les crimes avaient lieu. Mais demeure la question posée par Jean-Baptiste Thoret, celle du moment où, après coup, les médias se demandent ce qui doit être montré et ce qu’il faut censurer…
JBT : Oui, du point de vue du terroriste-émetteur, avec son canal privé de diffusion, il n’y a plus de média officiel. Chacun crée sa petite chaîne de télévision, si ce n’est qu’elle est prise dans un réseau absolument mondial. Mais il faut comprendre que l’émetteur produit une image brute, un rush intégral. Une exécution est filmée qui va durer deux, trois, cinq, dix minutes, etc. Et nous, dans la guerre des images qui est alors déclenchée, qu’est-ce qu’on se contente de faire ? On ne montre pas tout. Autrement dit, on a d’emblée du retard.
Sur ce sujet, abordons la circulation dans le temps des images du 7 octobre. D’abord, des images passent sur les réseaux sociaux, puis à la télévision. Ensuite, l’armée israélienne récupère les caméras GoPro sur les corps des terroristes du Hamas et se trouve donc en possession de dizaines d’heures d’images tournées par les criminels eux-mêmes. Les autorités israéliennes décident de monter un film d’un peu plus de 40 minutes, avec celles-ci et avec d’autres (des images de caméras de surveillances, notamment, ou des images filmées par les premiers secouristes arrivés sur les lieux des massacres). Elles organisent des projections ciblées devant des spectateurs choisis. On vous explique avant la projection que vous ne voyez qu’une sélection très partielle de ce qui peut être montré. On insiste sur ce fait : nous ne verrons qu’une partie de l’horreur. Tout ne peut pas être montré, comme s’il y avait un excès dans l’horreur qui résistait à la diffusion. Beaucoup de questions se posent à partir de ce protocole : à partir de quand c’est trop ? Qu’est-ce que cela signifie qu’on ne montre pas à tous, qu’on réserve l’accès à ces images à certaines personnes, jugées légitimes, capables de les raconter ? Ma première impression, pour ma part, a été que ces images embarrassaient Tsahal, qu’il hésitait et ne savait pas exactement comment procéder avec elles…
MP : Moi, contrairement à vous deux, je n’ai pas vu le film et je ne veux pas le voir. Les images que j’ai déjà vues m’ont suffi. Ce dont je peux parler, c’est de l’intention qui préside à cette projection. J’ai parlé des pionniers : j’ai évoqué le massacre de Nankin en 1937, j’ai évoqué les Einsatzgruppen… Mais il y a quelque chose qui ne peut pas être anticipé à travers ces cas, c’est la négation des images. Lorsque les nazis sont passés en jugement, qu’il s’agisse des hauts responsables ou des exécutants, jamais ils n’auraient pu imaginer nier le crime auquel ils avaient participé. C’est quelque chose qui vient après, même si c’est très rapidement : dès 1945, il y a des voix qui commencent à se faire entendre pour nier l’existence même du génocide. À partir de là, certains vont passer beaucoup de temps à réfuter les preuves, à dire que telle photo est truquée, qu’il s’agit d’un montage… Il va y avoir une véritable entreprise de destruction, de délégitimation des preuves en général, et particulièrement visuelles. Et évidemment, aujourd’hui, le rapport à l’image est encore plus décrié, déformé, suspecté qu’il ne pouvait l’être à l’époque. Avec Chat GPT, avec l’intelligence artificielle, il est extrêmement facile de truquer une image. Ça n’a plus rien à voir avec les moyens beaucoup plus artisanaux dont disposait par exemple Staline, bien qu’il nous ait déjà appris beaucoup de ce qui était possible. Donc on comprend qu’il y ait une défiance terrible à l’égard des images. C’est pourquoi, dans le cadre de la guerre qui se déroule sous nos yeux, il est important, voire essentiel, pour les Israéliens d’apporter immédiatement la preuve de ces massacres. Parce que les massacres du 7 octobre, et les images qui en témoignent ont été niés en temps réel.
C’est vrai que, dès le 8 octobre, on a pu entendre des gens nier les massacres et suspecter la réalité des images. Mais, de facto, l’immense majorité des images de ce film avaient déjà circulé avant la projection du film de Tsahal. Il s’agit avant tout d’un montage qui en propose une sélection. On pourrait dire qu’une grande partie de la matière avec laquelle le film est fait était déjà disponible. Donc certes, il y a bien cette intention de prouver ce qui s’est passé. Mais je m’interroge surtout sur la forme de ce film, sur le dispositif qui l’entoure, sur la manière dont il est conçu…
JBT : Si on se situe du côté de l’intention, on se dit que Tsahal cherche effectivement à apporter des preuves pour couper court à une espèce de désir négationniste. Évidemment, cela n’empêchera pas ce dernier d’avoir lieu, et de fait on a vu qu’il a déjà eu lieu. Mais j’imagine que l’intention de Tsahal est de produire un effet de sidération, quelque chose qui soit incontestable.
Cependant, j’affinerais le problème en posant la question des spectateurs, qui sont extrêmement divers. Je pense qu’on peut découper la masse des spectateurs, de façon un peu grossière et caricaturale, en trois catégories. Il y a ceux qui sont déjà convaincus, qui savent et qui ne veulent pas voir le film, parce que pour eux l’image serait insupportable et ne leur apprendrait rien. Ils savent déjà ce qu’il y a à savoir. À l’autre extrême, il y a ceux auxquels on pourrait montrer n’importe quelle image, ils diront que c’est fabriqué, faux, produit par une IA qui sert la propagande israélienne. Donc je dirais que ces deux catégories de la population, elles ne sont pas visées par Tsahal. D’une certaine manière, rien ne sert de leur montrer les images, il s’agit de causes déjà gagnées ou déjà perdues. On ne va pas chercher à convaincre ni les gens qui nous disent que ce n’est pas un acte terroriste, que c’est « seulement » un crime de guerre, voire un acte de résistance pour les pires d’entre eux ; ni ceux qui sont parfaitement au fait de l’existence de ce moment historique. Si je me mets à la place de Tsahal, ce qui est très compliqué, il me semble vain de cibler ces deux catégories de gens inamovibles : ce qu’il faut viser, c’est la zone intermédiaire. Je serais incapable de la quantifier, mais je fais le pari que ça vaut le coup de tenter de la viser, cette zone intermédiaire de gens qui hésitent, qui ne savent pas, qui sont dans le « oui, mais… ».
Je prends un exemple : Jean-Michel Ribes, à l’ouverture de la marche dite de la culture, marche pour la paix… Il dit alors : « Ces massacres des deux côtés ne sont pas humains. On est hors de l’humanité ». Cette phrase, elle n’est possible qu’à condition de placer une sorte d’équivalence : il y aurait eu des massacres perpétrés par les terroristes du Hamas et, en réponse, vengeance ou pas, les massacres produits par Israël. Qu’est-ce qui peut prouver qu’il n’y a pas une différence de degré d’un massacre à l’autre, mais une différence de nature ? Qu’est-ce qui peut le prouver ? Est-ce que c’est le discours d’un homme politique, d’un historien ? Je crois qu’il n’y a que l’image, quand bien même certains diront qu’elle est truquée. Ça, on n’y peut rien. À titre personnel, je trouve terrifiant cet effet de symétrie entre les deux massacres, et je pense que le seul moyen de l’éviter, lui et la négation pure et simple, c’est d’en passer par ces images de l’horreur.
Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont cela s’est fait, mais on voit bien qu’il y a quelque chose qui a été évité. C’est toujours le moment de l’exécution, toujours. On voit un début d’exécution dans une ou deux séquences seulement. Et puis, le grand refoulé de tout ça, ce sont toutes les violences sexuelles, les viols, les mutilations, les choses absolument abominables qui ont été faites aux les femmes israéliennes. Alors, on comprend bien pourquoi elles n’apparaissent pas ces images. Mais elles ont été racontées par des familles israéliennes, par beaucoup de gens, même si c’était dans un silence à peu près assourdissant, parce que les féministes ne sont pas montées au créneau. Or, ce sont justement ces atrocités qui constituent pour moi un des faits majeurs. Des atrocités voulues, programmées, rediffusées par le Hamas. Certains terroristes qui ont été capturés par Tsahal expliquent l’importance de dégrader les corps, ils décrivent les choses abominables qu’ils ont fait subir. Moi, je pense que l’événement il est dans ces atrocités, et que ce qui permettrait de différencier ce massacre-là, ce seraient précisément ces images. Or, celles qu’on a vues dans la production de 43 minutes, elles sont un peu en deçà du verbe, elles atténuent ce qui a été raconté. Par rapport à ce que je sais être arrivé, notamment sur les violences faites aux femmes, l’image-preuve se fait attendre, et finalement l’image est en deçà. Je pense que c’est ce qui manque : si on fait la guerre des images, si on se sert des images comme une arme de guerre, il faut que l’arme soit efficace.
MP : Il était question tout à l’heure de l’embarras des autorités israéliennes. À mon avis, on le voit là l’embarras, c’est ce qui détermine la sélection des images, avec la question du respect dû aux victimes. Il est là l’embarras des Israéliens : dans l’absence des images du viol utilisé comme arme de guerre. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu cette question-là. Il s’agit des images du massacre de Skede en Lettonie, perpétré par les supplétifs des nazis en décembre 1941. Un opérateur professionnel, dépêché par Berlin, avait pris une série de photos, qui nous est restée complète, d’un massacre dans toute son extension : depuis le déshabillage des victimes (femmes et enfants), jusqu’à leur exécution dans la fosse. On voit donc ces photos où des femmes nues passent devant ceux qui vont les assassiner, et qui jouissent visiblement de voir ces corps dénudés. Ces images, je les ai montées dans mon documentaire sur les Einsatzgruppen, et je me souviens des réactions à une des premières projections du film. Il y avait ce groupe de lacaniens, d’ailleurs assez âgés, qui avaient été épouvantés par le fait que j’utilise ces images, et j’avais trouvé leur réaction à la fois étrange et disproportionnée. L’un d’entre eux, qui était dans le public, est venu me voir pour m’expliquer. Il m’a rappelé la manière dont, immédiatement après la guerre, l’URSS a voulu témoigner du génocide qui s’était déroulé. Il s’agissait évidemment d’une opération de communication en leur faveur, et ils diffusaient donc ce genre d’images, en distribuant à l’échelle mondiale, donc y compris en France, ces gros albums photographiques. On est juste après la guerre, à une époque où l’image est encore très rare, difficile à trouver, surtout si on parle d’images de nudité. Ce monsieur vient donc m’expliquer une chose qui m’a marqué jusqu’à aujourd’hui, il me dit que, pour sa génération, c’était la première fois qu’ils avaient alors l’occasion de voir des images de femmes nues. Il me laisse donc entendre qu’au fond, quelque chose de leur initiation à la sexualité était passé par le visionnage de ces images. Évidemment, cela doit créer un traumatisme dans la psyché d’adolescents, de se trouver confronté à ce combo d’épouvante et de jouissance.
Je crois que, consciemment ou inconsciemment, les Israéliens ont peur de ça aussi. Du choc traumatique, de la détonation psychique que pourraient engendrer ces images, ce mélange de viol, de nudité, de violence et de meurtres.
Il est vrai qu’il y a l’enjeu pour Tsahal, et cela explique aussi son embarras, de ne pas poursuivre le geste de profanation en en montrant les images. Je pense que c’est probablement l’argument qui a été retenu pour justifier de couper au montage certaines des atrocités, notamment concernant les violences sexuelles. Mais je voudrais vous poser, Jean-Baptiste Thoret, la question de ce combo d’épouvante et de jouissance dont parlait Michael Prazan. Nous sommes évidemment aujourd’hui dans une configuration différente, au sens où le public a, contrairement à ce psychanalyste dont parlait Michael Prazan, l’habitude de ce genre d’images alors rares. Mais reste la question de cet entrelacement de l’effroi et d’une fascination qui vire à la possible jouissance du spectateur. D’autant plus que, dans ce film de 43 minutes, la question de la jouissance des bourreaux est absolument centrale. C’est peut-être ce qu’il y a de plus épouvantable dans ce film : le fait d’assister au plaisir que les bourreaux ont eu à perpétrer leur crime, la manière dont ils mettent en scène leur jouissance, cherchant à la prolonger dans l’image.
JBT : C’est un débat vieux comme les images. Quand Kubrick tourne Orange mécanique en 71, certains lui disent que ça serait extrêmement dangereux de montrer les exactions de Malcolm McDowell, notamment cette fameuse séquence de viol, parce que certaines personnes pourraient s’identifier au personnage principal, donc en l’occurrence au bourreau, et refaire la même chose.
C’est intéressant que vous parliez d’Orange Mécanique, parce qu’il y a une séquence qui montre ce que le film appelle « le traitement Ludovico » où le protagoniste est forcé de regarder des images atroces, où ses yeux sont maintenus ouverts pour qu’il ne puisse pas échapper à la vision des images atroces qu’on lui projette. Ce qui pose bien la question de savoir jusqu’où on peut et on veut regarder en face la violence, l’horreur, le mal dans l’histoire…
JBT : Oui, le traitement Ludovico, c’est déjà cette question de l’entrelacement de l’effroi et de la jouissance. Avec le 11 septembre 2001 aussi d’ailleurs, on retrouve cette espèce de mélange indécidable entre une fascination pour ce qui ressemble à un film hollywoodien, et un effroi devant ce qui a lieu, devant les cadavres. D’ailleurs, ces cadavres, on en voit très peu, ils sont refoulés hors champ. Il y a des morts, mais on avait à l’époque pris soin de ne pas montrer les corps des fameux « jumpers », de ces gens qui sautaient des tours. En fait, on voit que, dans les images prises sur le coup, ceux qui filment ont tendance à détourner la caméra pour éviter de filmer les corps. Et quand il en passe dans le cadre, ils sont ensuite expurgés au montage, un peu comme le fera Tsahal 25 ans plus tard en éludant les viols et les exécutions. Mais, à l’époque, ce qui ne peut pas être refoulé, ce qui crève l’écran, c’est une certaine jouissance du spectateur, la fascination pour ces scènes de destruction qui semblent venir réaliser une grande figure du cinéma catastrophe hollywoodien, le moment où tout s’effondre.
Mais il faut bien distinguer le réel et la fiction. On a l’habitude d’images qui sont construites à distance du spectateur, en ménageant un écart avec lui, images qui sont le propre de la fiction. Mais là le problème, auquel renvoie d’ailleurs le terme de sidération, c’est celui de la fin de l’écart, de l’impossibilité d’une distance, du sentiment d’être littéralement écrasé par des images dont on sait que ce qu’elles représentent a eu lieu.
JBT : Je crois que le réel et la fiction, c’est impossible de clairement les dénouer, et que ce sont justement ces cas qui nous obligent à assumer ce fait. Pour revenir au film de Tsahal, il me semble qu’on pourrait au contraire dire qu’il ménage une trop grande possibilité de distance pour le spectateur. Il y a un signe qui ne trompe pas : lors de la projection à laquelle nous avons assisté, personne n’est sorti pendant les 43 minutes. À mon avis, si les images projetées avaient été à la hauteur de ce qui s’est passé, il aurait été impensable que personne ne quitte la salle. Pour moi, c’est ça la question importante : est-ce qu’on donne à voir des images qui sont à la hauteur du réel qu’il enregistre ?
MP : Enfin, ces gens qui ont été massacrés, ils ont des parents, des familles, des amis. On comprend bien que ça ne peut pas être indifférent à la question de savoir quelles images peuvent être montrées et diffusées.
JBT : Bien entendu. Mais rien n’empêche jamais de flouter les visages ou l’identité, ce qui a d’ailleurs été fait dans ce film. Le problème avec cette logique, si vous voulez, c’est qu’on entre dans une sorte de schizophrénie. D’un côté on veut faire pencher la balance de son côté, éviter le négationnisme, ce qui implique de montrer ce qui a eu lieu. Et de l’autre, on met en place des opérations à peu près inverses, puisqu’on n’ose pas montrer l’horreur jusqu’au bout, on élude le pire. Je crois que si on s’engage vraiment dans la guerre des images, il faut pouvoir se servir de toute la puissance balistique dont on dispose. Surtout, il faut mesurer que cette guerre des images, elle prend place à l’époque des réseaux sociaux, où tout est visible.
MP : Il y a quelque chose qui me choque un peu dans ce que vous dites, même si je sais bien que ce n’est pas du tout votre intention. C’est cette idée que le film ne serait pas à la hauteur des attentes. Et là, d’une certaine manière, vous nous faites un peu basculer vers la fiction. C’est-à-dire qu’on irait à cette projection comme à un spectacle, qui pourrait décevoir nos attentes. Je crois qu’on s’engage là dans un terrain assez glissant. L’idée de ce film ne peut pas être de choquer pour choquer. On sait tous ce qui s’est passé, on sait tous qu’il y a eu des viols. Alors bien sûr il y a cette volonté de témoigner de ce qui s’est passé, mais on est obligé de faire une sélection dans les images, ne serait-ce que par respect pour les victimes. Il faut éviter de faire basculer ce débat dans une forme d’abstraction.
JBT : Ce que je veux dire, c’est que toutes les images possèdent leur part d’impureté. Un regard totalement pur devant une image est impossible, personne ne peut parfaitement faire le tri entre ce qui est de l’ordre de la jouissance ou de l’effroi. Les deux se mêlent toujours, même pour les gens les plus fréquentables et moralement ou éthiquement les plus dignes. Si on n’a pas conscience de ça, on va au-devant de revers. Ensuite, vous dites « on le sait tous pour les viols ». Mais non, ce n’est pas vrai. Ici, on sait, mais on ne sait certainement pas « tous ».
MP : Les journalistes et les parlementaires, qui constituent le public cible de ce film, ils le savent eux.
JBT : Oui, mais pensez-vous que l’écho autour des violences sexuelles, de ces atrocités qui ont été commises, soit à la hauteur de ce « on le sait tous » ? Non. Savoir maximal, transmission minimale. Donc il faut se poser la question de savoir ce qui pourrait faire basculer l’effet de banalisation, de symétrisation du massacre. Quelles images permettraient ça ? À mon avis, celles qu’on a vues l’autre jour ne feront pas l’affaire, elles n’apportent la preuve que d’une partie de ce qui s’est passé.
MP : Je n’ai pas envie de voir cette jeune fille de quinze ans violée, dépecée devant la caméra. Je sais que ces images existent, mais je n’ai pas envie de les voir. Pourtant, je ne pense pas être un spectateur lambda, mais je ne partage pas cette idée qu’il serait nécessaire de les voir.
La dernière question que je voudrais vous poser, c’est celle de savoir quel genre de travail documentaire on pourrait produire à partir de ces images. Je parle de l’avenir, en dehors de cette guerre des images, pour remettre de la distance, un écart.
MP : Il faudra du temps, mais je suis sûr qu’il y aura des films à partir de ces images, qu’il y aura des documentaires critiques, où l’on pourra lire une intention, un commentaire sur l’événement. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, on reste vraiment dans le brut de brut. Ces images sont appelées à rester et à témoigner de ce qui s’est passé, la distance à leur égard viendra avec le temps. Mais tant que cette distance ne s’est pas instaurée, nous sommes dans un rapport extrêmement embarrassé avec elles. D’abord parce que les montrer, c’est d’une certaine manière prolonger le geste, accomplir le désir de ceux qui les ont filmées. Et donc parce qu’inévitablement, une partie des spectateurs sera galvanisée par ces images. C’est une évidence contre laquelle on ne peut rien.
JBT : Oui, mais l’autre chose, c’est justement de savoir dans quelle temporalité on veut inscrire ces images : le présent des nécessités politiques et historiques, ou celui lointain des archives ? Quand Tsahal organise cette projection, c’est quand même avec l’intention de peser sur l’histoire en temps réel, aujourd’hui, à la fin du mois de novembre. Le premier objectif est évidemment de renverser l’argument négationniste et de chercher à rééquilibrer la balance de l’opinion mondiale. La visée est politique. Mais on peut aussi concevoir ces images dans le temps long de l’archive, les destiner dans vingt ans à des documentaires… Les motifs de dignité des victimes, d’effroi devant l’horreur, que je comprends parfaitement, jouent d’ailleurs en ce sens. Seulement, l’histoire, elle aura eu lieu, et il serait dommage de n’avoir pas cherché à infléchir son cours. Je pense que dans l’embarras de Tsahal, on perçoit aussi cette difficulté à savoir si les images doivent être inscrites dans le temps présent, ou si elles travaillent déjà, et peut-être exclusivement, pour la mémoire.
MP : À mon avis, vous surestimez la capacité d’influence politique de ces images. Elles ne font pas basculer les points de vue ni les postures, ce dont on a eu la preuve en direct, lors du visionnage par les députés LFI. Ces images n’ont pas eu un impact suffisant pour leur permettre de changer de point de vue, de prendre conscience de l’événement historique.
Jean-Baptiste Thoret vous dira que c’est parce que le film n’est pas à la hauteur.
JBT : Et surtout que ces députés n’appartiennent pas à la zone intermédiaire, mais savent déjà ce qu’ils veulent croire !
MP : Avec cette guerre, une hémiplégie compassionnelle, de part et d’autre, nous a sauté aux yeux. Quelqu’un qui a été extraordinairement choqué par les images du 7 octobre, voire même par l’idée de ces images, va avoir du mal à compatir aux images de bombardement sur des civils à Gaza avec des femmes, des enfants qui meurent. De la même manière, et de manière peut-être même encore plus spectaculaire, les propalestiniens ou pro-Hamas, selon leur degré de connaissance du conflit, sont avant tout touchés par ces images de bombardements israéliens et balaient d’un revers de main, dans le pire des cas, les images qui ont été tournées par les terroristes face aux massacres qu’ils ont commis le 7 octobre. Ces positions-là sont inamovibles et l’image ne la change pas.
Propos recueillis par Stéphane Bou
Michael Prazan est réalisateur et écrivain. Il est notamment l’auteur d’une histoire du terrorisme, d’une enquête sur les frères musulmans, et d’un travail sur les Einsatzgruppen.
Jean-Baptiste Thoret est réalisateur, historien et critique du cinéma. Il a notamment été de nombreuses années critique à Charlie Hebdo, où il était en train de se rendre au moment où l’attentat contre sa rédaction a été commis. Il a beaucoup écrit et travaillé sur la violence des images – à la fois dans l’histoire du cinéma de fiction, mais aussi documentaire.