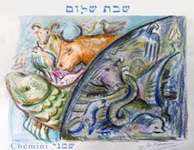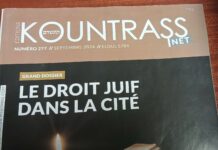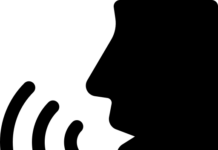Face aux intimidations et menaces, le commissaire du service pénitentiaire israélien (Shabas), Kobi Yaakobi, et le ministre Ben Gvir ont prouvé qu’une autre approche était possible : finies les cantines, les repas de luxe, les prières de masse et les télévisions.
Passé et présent — impressions de longues visites dans trois prisons de sécurité.
Ma’ariv – Liebskind
Depuis des années, je suis ce qui se passe dans nos prisons de sécurité, essayant sans cesse de décrire dans cette chronique à quoi ressemblait la « maison de repos » dont jouissaient les terroristes incarcérés chez nous, après avoir assassiné, tiré, fait exploser et massacré des Juifs.
En gros, l’objectif que s’était fixé le Service pénitentiaire, sous la pression du Shin Bet, était de tout faire pour « rentrer à la maison en paix ».
Le Shabas offrait aux terroristes tout ce qu’ils demandaient, leur faisant comprendre que tant qu’ils n’occasionnaient pas de troubles majeurs, il était prêt à satisfaire tous leurs besoins et qu’il n’avait aucune intention de s’affronter à eux pour quoi que ce soit.
Eux, de leur côté, bénéficiaient de la télévision, de la radio, lisaient des journaux quotidiens, organisaient des prières de masse dans la cour de la prison comme s’ils étaient dans une mosquée à Jénine, échangeaient des livres à la bibliothèque, poursuivaient des études universitaires, se procuraient des friandises à la cantine, et recevaient une livraison régulière de viande et de poisson frais qu’ils cuisinaient eux-mêmes dans des coins aménagés dans leurs cellules.
Il y a quelques années, lors de l’enquête gouvernementale sur l’évasion de la prison de Gilboa, le commissaire à la retraite Haim Glick, ancien vice-commissaire du Shabas, a envoyé une lettre alarmante soulignant la racine du problème : « Nulle part dans le monde occidental, on ne trouve des conditions pareilles. Les conditions de détention des terroristes en Israël sont bien meilleures que celles offertes aux terroristes ailleurs dans le monde occidental… Le sentiment est celui d’un club privé de luxe. »
Il ajoutait : « Dans ce club, rappelons-le, nous avons affaire à des assassins contre lesquels nous souhaitons instaurer une véritable dissuasion. Cette situation génère une confusion morale et érode notre instinct naturel. »
À la fin de l’année 2022, Itamar Ben Gvir est nommé ministre de la Sécurité nationale. En janvier 2024, il nomme Kobi Yaakobi comme commissaire du Service pénitentiaire israélien (Shabas). Ce dernier décide immédiatement d’une révolution : rien de ce qui existait jusqu’alors ne perdurera. L’ère du « country club » est révolue. Les conditions de détention ont été durcies. Les terroristes ont découvert, pour la première fois, ce que signifient détermination et souveraineté.
Le chemin n’a pas été simple. Le Shin Bet a alerté, les anciens du Shabas ont averti, mais la réalité a prouvé que tout ce qui manquait pendant des années à cette organisation était quelqu’un ayant le courage de changer.
Dans les dernières semaines, j’ai demandé — et obtenu — l’autorisation de passer de longues heures dans plusieurs prisons de sécurité : la prison de Ktziot, la prison d’Ofer et l’aile « Rakafet » du complexe du Shabas à Ramla, où sont détenus sous terre 84 des plus dangereux terroristes de la force « No’hba ». J’ai parlé avec des officiers et des commandants, je suis entré sous escorte dans les cellules des terroristes, j’ai observé leurs conditions et comparé avec ce que j’avais moi-même publié à maintes reprises par le passé. La conclusion est claire : c’est une révolution totale. Tout ce qui existait auparavant a disparu sans laisser de trace. Un commissaire déterminé, soutenu par un ministre déterminé, combiné au traumatisme collectif israélien du 7 octobre, a complètement changé la réalité.
Signature d’accords à la poignée de main
Avant de décrire la situation actuelle dans les prisons, rappelons le quotidien qui régnait jusqu’à récemment.
Cela apparaissait clairement dans la série documentaire « Megiddo », diffusée sur Yes Docu il y a quelques années.
Le réalisateur Itzik Lerner a obtenu l’autorisation de filmer pendant plusieurs mois dans la prison de Megiddo : caméras, enregistrements, interviews de prisonniers et de gardiens.
Le résultat était sidérant. La série révélait la capitulation totale du Shabas de l’époque, cherchant à « acheter la paix » avec les pires terroristes.
Les prisonniers étaient divisés par groupes, selon leur affiliation à des organisations terroristes (Hamas, Fatah, Jihad Islamique, etc.). Chaque organisation recevait son propre quartier. Chaque quartier avait un leader et un porte-parole, chargé de négocier au nom de ses camarades avec l’administration pénitentiaire.
Dans la série, on voit les négociations pour les heures de tennis de table (!) ; on assiste aux discussions sur la livraison des nouveaux téléviseurs promis aux membres du Hamas ;
on observe des commandants s’excusant devant des détenus pour des inspections de sécurité jugées « offensantes » envers leurs familles.
Quand un commandant imposait une légère punition pour un retard à un rassemblement, un « leader Hamas » venait négocier, et tout se réglait par une poignée de main amicale, comme entre un directeur d’usine et un délégué syndical — et non entre des gardiens et des terroristes.
Dans une scène encore plus absurde, on voit un commandant en réunion avec tous les porte-paroles des différents quartiers, chacun déposant ses doléances : l’un réclame le retour des œufs mollets au menu, l’autre se plaint de problèmes de télévision.
Les cellules elles-mêmes ressemblaient à des salons familiaux : cuisines improvisées, repas conviviaux, fêtes, prières de masse, élection interne des représentants Hamas (sous la supervision de l’administration !), etc.
Aujourd’hui, plus rien de tout cela
Alors, où en est-on aujourd’hui ?
Tout cela appartient au passé.
Cette semaine, le journaliste Ahikam Himmelfarb de Channel 14 a diffusé un extrait d’un podcast avec un ancien membre du Jihad islamique, condamné à perpétuité pour le meurtre d’un Juif il y a vingt ans et récemment libéré : « Ben Gvir disait que c’était des camps de vacances. Certains trouveront qu’il exagérait, mais franchement, c’était vraiment des camps de vacances. Les relations avec les officiers, la direction, la police – c’était comme une grande famille. »
Aujourd’hui, l’époque où chaque organisation avait son quartier — aile Hamas, aile Fatah, aile Front populaire — est terminée.
Le commissaire Kobi Yaakobi a décidé de mélanger tout le monde.
Le Shabas n’a pas pour rôle de maintenir l’ordre entre organisations terroristes, expliquait-il.
Face aux mises en garde du Shin Bet (« vous jouez avec le feu »), Yaakobi a répondu :
« Celui qui veut la guerre, l’aura. »
Mélanger les affiliations empêche la formation de hiérarchies et de leaderships en prison.
Un Fatah ne se confiera pas à un Hamas. Cela fragilise les organisations et renforce la capacité du renseignement à obtenir des informations.
À la prison d’Ofer, en milieu de journée. Dans le couloir menant aux quartiers de détention, les gardiens transportent sur des chariots les plateaux-repas des détenus.
Chaque repas est strictement calibré en calories. « Personne ne reçoit une goutte de plus ni une miette de moins que ce qui est prévu, » explique le commandant de la prison, le sous-commissaire Vadim Goldstein, en ouvrant les plateaux pour démonstration.
Peu après, une équipe de combattants pénitentiaires fait irruption dans une cellule pour une fouille surprise. Les onze détenus sont extraits et transférés dans la cour.
Le commandant de l’aile explique la différence abyssale entre le passé et le présent : « Ici, au bout du quartier, il y avait une cantine. Chaque prisonnier pouvait commander ce qu’il voulait : viande, poisson, sucreries, snacks. Nous fournissions tout, et ils cuisinaient eux-mêmes dans les cellules. Si quelqu’un commandait une viande n° 5 et recevait une viande n° 4, c’était une émeute. »
Il sourit, gêné.
Fin des cantines royales
Les cantines étaient la cerise sur le gâteau des terroristes, dans toutes les prisons.
La situation était presque irréelle : l’Autorité palestinienne, avec l’accord d’Israël (!), déposait de l’argent pour chaque détenu. Avec cet argent, les prisonniers achetaient des produits de luxe.
Entre 2015 et 2021, plus de 200 millions de shekels ont ainsi été déposés pour eux.
Le Shabas, pour maintenir la « paix sociale », permettait aux détenus d’avoir dans leur cellule des plaques chauffantes et des cuisinières. Ils cuisinaient comme s’ils séjournaient dans un Airbnb. Dans ces conditions, les prisons ne représentaient aucunement un facteur de dissuasion. Au contraire : elles devenaient un symbole de l’absurdité israélienne.
Des terroristes ayant tué des Juifs vivaient comme des rois, priaient ensemble, jouaient au foot, regardaient des matchs, mangeaient les meilleurs repas — souvent mieux que chez eux, pendant que leur famille touchait en parallèle des allocations de l’Autorité palestinienne.
Réalité actuelle
« C’est fini. Tout a changé, » décrit le commandant de l’aile. « Aujourd’hui, plus personne ne reçoit un gramme de plus que ce qui est prescrit. Et ce n’est pas tout : avant, si on voulait parler à un détenu, il fallait passer par son ‘porte-parole’ — comme un président de syndicat. Impossible de traiter un prisonnier individuellement. » La « porte-parole » interne avait des conséquences sécuritaires dramatiques : chaque prisonnier était considéré comme représentant officiel de son organisation terroriste. Un simple différend entre l’administration et un détenu pouvait dégénérer en incident diplomatique avec Mahmoud Abbas ou Yahya Sinwar !
Aujourd’hui, il n’y a plus de porte-parole, plus de leaders, tous les prisonniers sont égaux.
Autre exemple : auparavant, des « fonctionnaires » détenus distribuaient la nourriture, exerçant un pouvoir énorme (transferts illégaux d’objets, gestion préférentielle des rations). Cela a cessé. Désormais, avant chaque repas, le Shabas désigne au hasard un prisonnier différent pour distribuer — sans hiérarchie.
Cellules vides
Il fut un temps où les cellules ressemblaient à des dortoirs d’adolescents désordonnés : des montagnes de vêtements, d’objets personnels, de jeux. Aujourd’hui, dans les cellules de Ktziot ou d’ailleurs : rien d’autre que les lits, une assiette, un gobelet, une cuillère en plastique, deux tenues, deux serviettes, quelques sous-vêtements. Et c’est tout.
Plus de baccalauréats en prison
Par le passé, des jeunes Palestiniens, encore lycéens, étaient tentés de commettre de « petits délits sécuritaires » (jets de pierres, etc.) uniquement pour être emprisonnés et finir leur bac en prison. Sous la protection du Shabas, ils révisaient leurs examens en détention, bénéficiaient de facilités via l’Autorité palestinienne, et passaient leurs examens par téléphone public.
Tout cela est terminé. Il n’y a plus d’études, plus de diplômes, plus d’examens, plus de conférences universitaires. Aucun terroriste n’aura plus la possibilité de sortir de prison muni d’un diplôme universitaire.
Fin des douches illimitées
Vous souvenez-vous des rapports sur des terroristes prenant de longues douches pour gaspiller de l’eau et endommager les installations ?
C’est fini aussi. Le commissaire Yaakobi a ordonné que les douches soient retirées des cellules. Désormais, chaque prisonnier a une heure de promenade par jour sous surveillance, incluant le temps de douche. Les douches sont publiques, situées au bout de la cour. L’eau s’arrête automatiquement après quelques minutes, contrôlée par les gardiens. Pas de gaspillage, pas d’abus.
Fin du « salon d’accueil » des terroristes
Dans le passé, lorsqu’un gardien entrait dans une cellule, il était accueilli par les prisonniers pour une discussion amicale, à hauteur d’homme. Aujourd’hui, c’est fini. À l’aile Rakafet, dans le complexe de Ramla, j’ai pénétré une cellule de trois terroristes du commando maritime du Hamas (« Nukhba »). Petite cellule : trois lits, quatre murs. Rien d’autre. Avant d’entrer, les gardiens frappent à la porte, et les terroristes doivent se mettre à genoux, mains derrière la tête, dos tourné à la porte.
Fin des boulangeries de luxe
Vous souvenez-vous du scandale des boulangeries de pita dans les prisons ? Autrefois, le Shabas exploitait quatre boulangeries internes. Les coûts comprenaient l’entretien, le personnel et la sécurité. Chaque terroriste recevait six pitas fraîches par jour (!), réduites ensuite à cinq. Après la décision de Ben Gvir de fermer ces boulangeries, le Shabas est passé à l’achat de pain industriel en quantités limitées, puis à des tranches de pain standard, respectant le strict minimum alimentaire selon les critères internationaux.
Résultat :
- Plus d’entretien coûteux,
- Plus d’agents mobilisés pour la sécurité des boulangeries,
- Plus d’impression de « colonie de vacances ».
Fin des téléphones publics et sabotage des communications
En 2019, le ministre Gilad Erdan avait tenté d’installer des brouilleurs cellulaires dans les prisons. Le chef du Shin Bet de l’époque, Nadav Argaman, s’y était opposé, craignant des émeutes, et avait plutôt proposé… d’introduire des téléphones publics pour les prisonniers ! Aujourd’hui, cette absurdité a été corrigée : le commissaire Yaakobi a ordonné l’activation continue des systèmes de brouillage et l’enlèvement total des téléphones publics. Parallèlement, de nouveaux dispositifs de brouillage plus avancés sont en cours d’installation, en coopération avec les compagnies de télécommunication.
Fin des prières de masse et des slogans criés
Vous souvenez-vous des prières de groupe et des cris « Allah Akbar » qui résonnaient dans toutes les prisons ? Aujourd’hui, tout cela est interdit. Qui veut prier, prie en silence, individuellement. Les cris collectifs sont punis sévèrement.
Le mot-clé aujourd’hui dans les prisons est : « Souveraineté ».
Lors de la nuit des missiles iraniens, rappelle le commandant Goldstein de la prison d’Ofer, certains prisonniers avaient commencé à taper sur les portes. Ils furent immédiatement punis. Pourquoi tant de rigueur ? « Parce qu’aujourd’hui, tu tolères les coups sur les portes, demain tu perds le contrôle. »
Zéro tolérance
Le jour de ma visite à Ktziot, le commandant adjoint Dima Wilderman a envoyé dix terroristes en isolement pour une semaine. Leur faute ? Deux graffitis trouvés sur le mur de leur cellule :
- « Gaza sera reconstruite »,
- « Résistance sous forme de poing levé ».
Avec le retrait des télévisions et radios, les détenus sont presque totalement déconnectés du monde extérieur. À part leurs avocats (et là encore sous surveillance stricte), ils n’ont plus de canaux d’information.
Le Shabas a également engagé une lutte sévère contre les avocats complices de la transmission de messages terroristes : plus de 20 plaintes ont été déposées contre eux auprès du barreau israélien.
La fin du modèle de la « concession »
Dans plusieurs prisons, les gardiens racontent sans nostalgie la puissance qu’avaient les prisonniers avant le 7 octobre. Par le passé, un simple changement de conditions de détention provoquait des menaces de tirs de roquettes depuis Gaza.
Face à cela, le Shabas reculait : dans un cas documenté, un téléphone avait même été fourni à un terroriste pour calmer ses camarades à Gaza !
Le modèle dominant était celui de l’apaisement et de la concession permanente, au lieu de la fermeté.
Aujourd’hui, face aux milliers de terroristes incarcérés — représentants des organisations meurtrières — un véritable processus de redressement est en cours.