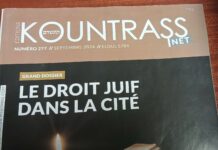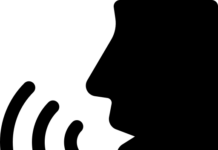Jeudi 13 février, Aurore Bergé, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations, a annoncé qu’une campagne de lutte contre l’antisémitisme serait déployée dans l’espace public. Mais cette campagne qui prenait le risque de créer ce qu’elle dénonce n’aura finalement pas lieu. Pourquoi ce qui partait d’une bonne intention aurait pu être un échec psychologique et stratégique ?
Lors des “Assises de lutte contre l’antisémitisme”, la ministre Aurore Bergé a présenté une campagne supposée réagir à l’explosion des actes antisémites. Deux affiches se posent sur l’écran géant. Sur chacune, un personnage de trois-quarts dos, un homme, une femme, en noir et blanc et, en énormes caractères “Sale juif”, “Sale juive”. Suit une contextualisation en tout petit: “C’est ce que mon fils a entendu à la fac” / “C’était tagué sur ma porte”. Et enfin, un slogan et son QR code: “Ensemble, faisons taire la haine”.
Cette campagne, pour vertueuse qu’ait été son intention, aurait pu être un choc visuel, intellectuel et émotionnel mal dirigé et potentiellement dramatique. Elle est née d’une volonté sincère, elle aboutit sur une erreur magistrale.
Ajoutons que cette campagne s’inspirait sûrement d’une autre campagne, datant de 2004, de l’UEJF, avec deux visuels montrant Jésus et Marie. Sur chacun apparaissaient les mots « sale juif » et « sale juive ». Et une question: « L’antisémitisme: et si c’était l’affaire de tous ? » À l’époque, cette campagne avait été dénoncée par la Licra qui la jugeait contre-productive.
Le paradoxe de l’exposition brutale
Avant toute chose, on se demande ce qu’ont pu anticiper les concepteurs de cette campagne de l’effet que peut produire pour un Juif, une Juive, un ado juif ou un enfant juif, l’affichage de ces mots “Sale juif” / “Sale juive” dans le métro du matin, dans la rue, dans la vie. Mais surtout, au-delà des Juifs, se pose un danger : celui de l’habituation, théorisé par le psychologue américain Robert Zajonc sous le nom d’“effet de simple exposition”.
Zajonc écrit en 1968: “L’exposition simple à un stimulus suffit à améliorer notre attitude à son égard, même en l’absence de reconnaissance consciente de cette exposition”. Il faut relire le philologue allemand Victor Klemperer, et notamment cette phrase “Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic: on les avale sans s’en apercevoir et, au bout d’un temps, l’effet se fait sentir” pour commencer à percevoir ce que dit un autre psychologue, français, cette fois, Serge Moscovici: “La normalisation est ce processus par lequel un groupe de référence absorbe progressivement une idée déviante jusqu’à l’intégrer comme une norme implicite”.
Dans Il y a l’antisémitisme, le philosophe et psychanalyste (et artisan besogneux de Tenoua) Stéphane Habib développe l’idée de l’antisémitisme comme une langue, une langue qui, si on l’adopte, porte une façon de lire le monde. Autrement dit: on ne se contente pas de dire l’antisémitisme, on le parle.
Appliqué à cette campagne, cela signifierait que l’État français, en ayant souhaité afficher ces mots, les aurait non seulement signalés, mais aussi performés. Un tag “Sale juif” sur un mur est déjà une agression. Mais quand ces mots sont imprimés, affichés officiellement, financés par l’État, placardés dans l’espace public avec les codes couleur du bleu, du blanc et du rouge, ils ne sont plus seulement un constat, ils deviennent une réalité légitimée. Même dans un but (vertueux) dénonciateur, cette écriture publique leur donnerait une existence renforcée.
Le biais de confirmation
Allons plus loin, puisque les Juifs ne sont pas les seuls à prendre le métro ou à se balader dans les rues de Paris et d’ailleurs. Selon le psychologue cognitif britannique Peter Wason, “les gens ont tendance à rechercher des informations qui confirment leurs croyances plutôt que de les contredire”. Dans notre affaire, cela signifie que des gens qui portent avec eux des préjugés antisémites auraient pu voir, plutôt qu’un questionnement, une validation implicite de leur vision atrophiée. Plus grave, il aurait été possible qu’une personne non directement concernée (qui ne serait ni juive ni haïssant les Juifs) ne perçoive que l’insulte, sans avoir ni la proximité ni la disponibilité de lire le reste. Il lui restera ceci: “Sale juif / sale juive”.
L’effet boomerang
Abordons également la brutalité du message et le risque d’un effet retour. Un message brutal provoque un effet naturel de rejet. C’est ce que documentent les psychologues américains Sharon et Jack Brehm lorsqu’ils disent que “la réactance psychologique est un état motivationnel négatif qui survient lorsqu’un individu perçoit que sa liberté de choix est restreinte ou menacée. Cette perception déclenche une motivation à restaurer cette liberté, souvent en adoptant le comportement interdit ou en rejetant le message imposé”.
Autrement dit, l’État aurait agi comme si le stigmate antisémite ne signifiait pas aujourd’hui aussi (et comme si souvent dans le passé) un rejet de ce qu’est l’État, des institutions et de toute forme d’étatisme: si l’État dit “n’attaquez pas les Juifs”, l’esprit “contestataire” en conclut “attaquons les Juifs”, même sans y croire plus que ça. Au-delà de ces extrêmes, les gens auraient pu percevoir la campagne comme une tentative de manipulation pour leur faire ressentir de l’émotion ou de la culpabilité, ils auraient pu être enclins à développer une forme de désensibilisation, voire de rejet du message. Il n’est nul besoin de regarder loin pour se souvenir que certaines campagnes anti-tabac hyper-snuff ont excité l’esprit contradictoire de rébellion d’une certaine jeunesse.
La paralysie de l’impuissance
Je me souviens vaguement, j’avais alors 13 ans, d’une campagne d’affichage sur le génocide des Tutsi au Rwanda dans le métro parisien: “Quand vos enfants vous demanderont ce que vous avez fait, ….” avec l’image d’un enfant agonisant ou “machetté” ou une autre image choc. J’avais beau n’être qu’un ado, je me disais déjà que cette campagne manquait son but : qu’est-ce que mes parents auraient bien pu faire pour empêcher le génocide des Tutsi au Rwanda ? Contrairement à “Touche pas à mon pote” ou d’autres campagnes qui voulaient engager, cette campagne qui allait être menée par l’État français contre l’antisémitisme, rate le coche et, pire, aurait bien pu produire l’inverse de ce qu’elle souhaite, un rejet de la cause juste.
Le psychologue américain Martin Seligman a théorisé “l’impuissance apprise” ou l’idée que si une personne est exposée de manière répétée à un problème sans solution, elle finit par se résigner au lieu d’agir: “Lorsque des individus font l’expérience d’échecs répétés ou de traumatismes sans contrôle, ils développent la croyance que leurs actions n’ont aucun effet, ce qui entraîne une passivité”. Le risque ? Que les non-Juifs et non concernés se détournent de la lutte contre l’antisémitisme tant elle semble vaine.
Pourquoi l’injure ?
Oui parce qu’il y a bien “sale” devant “Juif” ou “Juive”. Il y en a eu d’autres, des campagnes antiracistes de l’État, surtout dans le sport, contre les préjugés racistes, contre l’homophobie, etc. Mais souvent, la parole raciste était biffée, barrée, assortie d’un franc “Non !” Sur les affiches présentées hier, ce n’était pas le cas. Pire, il n’y avait aucun appel à l’action.
L’enfer est pavé de bonnes intentions
Nulle personne honnête ne pourrait soupçonner l’État et le gouvernement français d’être antisémites. Il faut le dire : les Juifs sont en France la seule population qui peut être, et depuis des années, aléatoirement ciblée et assassinée uniquement pour ce qu’elle est ou supposée être. Et pourtant, durant toutes ces terribles années, l’État français et ses institutions n’ont jamais abandonné les Juifs (ni guère plus les autres États européens). C’est ce qui rend absolument inopérante toute comparaison avec la situation des années trente que, pourtant, on entend bien trop souvent.
Ici, l’État voulait bien faire et était de bonnes intentions, mais il a joué un jeu dangereux en adoptant malgré lui la langue de l’antisémitisme. Il aurait pu favoriser sans le vouloir cette habituation en n’appelant à aucune action concrète. Longtemps, j’ai pensé que nous aurons gagné quand les écoles juives n’auraient plus à être gardées par des forces de l’ordre et le SPCJ. Désormais je me mets à penser que nous aurons gagné quand nos écoles seront gardées par des non-Juifs, qui protégeront nos enfants comme les leurs parce qu’ils les considéreront comme les leurs.
Nous avons appris que cette campagne ne serait pas diffusée et qu’une autre serait pensée de façon plus collective, avec des associations engagées dans la lutte contre l’antisémitisme. À l’avenir, l’État devrait écouter la voix de ceux qui subissent l’antisémitisme plutôt que de parler à leur place. L’antisémitisme se combat par l’éducation et par la loi, en aucun cas par une exposition brute à la haine. Jamais la langue de l’antisémitisme ne peut être endossée par l’État, même avec les meilleures intentions du monde.