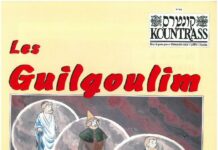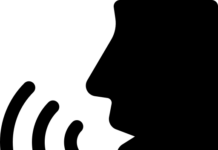Depuis plusieurs mois, Tsahal traverse une période de remaniement profond, conséquence directe des événements tragiques du 7 octobre. Dans un contexte de bouleversements internes et de pressions politiques, l’armée israélienne s’apprête à publier ses enquêtes, un ensemble d’investigations internes qui devrait être dévoilé entre le 25 février et le 4 mars. Ces investigations, conçues pour faire la lumière sur le massacre du 7 octobre, marquent une réorganisation majeure dans la gestion de la sécurité nationale.
Cette dynamique de pression interne s’inscrit dans un remaniement plus large. Le 5 mars, le général de division Eyal Zamir aura officiellement pris les rênes en tant que nouveau chef d’état-major, succédant ainsi à Halevi. Ce changement de direction intervient alors que la plupart des responsables impliqués dans les événements du 7 octobre ont déjà posé leur démission ou se trouvent sur le point de quitter leurs fonctions. La transition semble donc être une réponse aux critiques internes et à la nécessité de renouveler le commandement dans un climat de défiance généralisée.
Au-delà du remaniement hiérarchique, un débat intense a animé les sphères politiques. Halevi et certains responsables militaires avaient initialement plaidé pour la mise en place d’une commission d’enquête d’État. Cette instance devait examiner non seulement les défaillances opérationnelles et sécuritaires, mais également les décisions stratégiques prises par le gouvernement, notamment celles du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Cependant, inquiet des retombées politiques que pourrait engendrer une telle investigation, Netanyahu a reporté indéfiniment sa création, préférant éviter de mettre en lumière des choix qui pourraient le relier aux échecs de sécurité constatés.
Les conséquences de ces bouleversements se font également ressentir dans les services de renseignement. Le chef du renseignement de Tsahal, le général de division Aharon Haliva, a démissionné en août 2024. Son départ a été rapidement suivi par celui de ses principaux collaborateurs, parmi lesquels figurent les responsables de l’analyse, de l’unité 8200 – souvent comparée à la NSA israélienne – et d’autres assistants stratégiques. Ce désengagement massif au sein de l’appareil de renseignement souligne l’ampleur du malaise et la remise en question de l’efficacité des mécanismes existants.
Le commandement sud de Tsahal n’est pas épargné non plus. Le général de division Yaron Finkleman a présenté sa démission le 21 janvier, le même jour que Halevi, en attendant que Zamir puisse nommer un successeur apte à réformer le secteur des ressources humaines et redéfinir les priorités stratégiques. Parmi les noms évoqués figure celui du général Yaniv Asur, ancien responsable des ressources humaines, qui, malgré l’absence de promotion sous la direction de Halevi, pourrait trouver sa place dans le nouveau schéma établi par Zamir. Certains observateurs y voient une convergence entre les attentes de politiciens de droite et les orientations stratégiques envisagées pour l’avenir de l’armée.
D’autres départs notables concernent également des commandants d’unités opérationnelles, notamment au sein des divisions actives à Gaza, où des remaniements avaient déjà été amorcés avant même que les enquêtes ne soient publiées. Cette succession de démissions traduit une volonté de prise de responsabilité individuelle et collective, dans un contexte où l’institution cherche à se reconstruire.
L’ensemble des investigations se divise en quatre macro-axes. Le premier volet porte sur l’ensemble des concepts de sécurité nationale appliqués à la gestion de Gaza. Il englobe la stratégie de défense, la technologie de clôture frontalière – dont l’investissement se chiffre en plusieurs milliards – ainsi que le développement des concepts opérationnels et du renseignement, essentiels pour décrypter la menace représentée par le Hamas. Le deuxième axe se concentre exclusivement sur l’analyse des renseignements concernant le Hamas, en évaluant sa capacité à mener une guerre et en questionnant la tolérance aux opinions divergentes au sein des services de renseignement. Le troisième volet se penche sur les décisions et les ordres émis la veille de l’invasion, moment critique où la perception de la menace a évolué. Enfin, le dernier axe examine les choix stratégiques et les batailles menées pendant la journée de l’invasion et dans les 72 heures qui ont suivi, période durant laquelle l’armée israélienne a progressivement repris le contrôle des 22 villages initialement capturés par le Hamas.
Ce vaste dispositif d’enquêtes et de réorganisations illustre la volonté de Tsahal de tirer les leçons d’un épisode douloureux. Les réformes entreprises visent à renforcer la sécurité nationale et à restaurer la confiance dans une institution qui se trouve aujourd’hui à un tournant décisif. Alors que les enquêtes devraient mettre en lumière les défaillances passées, elles ouvriront également la voie à une refonte stratégique pour mieux anticiper et contrer les menaces futures.
Jforum.fr