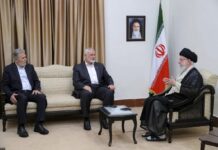Interview. Toujours présente mais différente, la haine antijuive persiste plus d’un siècle après l’affaire Dreyfus, déplore Alexis Lacroix.
Le 13 janvier 1898, l’écrivain Émile Zola publiait dans l’Aurore le célèbre « J’Accuse…! », lettre ouverte pour dénoncer les manigances dans le procès du capitaine juif Alfred Dreyfus. Loin d’avoir disparu depuis, le préjugé antijuif se réactive sous une forme contemporaine, estime Alexis Lacroix. L’éditorialiste et directeur délégué de la rédaction de l’Express dénonce dans son nouvel ouvrage un néo-antisémitisme issu aussi bien d’une « drumontisation islamo-gauchiste d’une partie des progressistes » que d’un nationalisme français dévoyé. Une thèse “géo-politiquement incorrecte” à laquelle on ne souscrit pas forcément mais qui a le mérite de mettre au jour les forces d’influence qui s’affrontent dans la société française.
Pourquoi s’intéresser à l’affaire Dreyfus, cent vingt ans après ?
Ce besoin de regarder “dans le rétroviseur”, vers une époque où les Français se sont déchirés sur le sort d’un petit officier, peut étonner. Il s’agit pourtant d’un réservoir de leçons historiques importantes pour la période actuelle. Cette affaire a représenté le moment culminant d’un brouillage entre la droite et la gauche, qui a débouché sur un populisme antirépublicain très violent. Elle signe la naissance d’un certain modèle d’intervention dans la Cité : ceux qui vont monter au front pour l’honneur du capitaine sont, en effet, les hommes de lettres et de presse, Émile Zola, des condisciples de Péguy, des savants et des poètes mais aussi un peintre, Claude Monet. Sans oublier un directeur de journal également homme politique, le radical Georges Clemenceau, qui eut un rôle fondamental dans l’éveil des consciences en théorisant le fait que l’iniquité envers un seul homme équivalait à se rendre coupable d’une iniquité envers tous. Cette conscience civique a donc été incarnée par les intellectuels, davantage que par les politiques. Parmi ces derniers, celui dont on célèbre encore le rôle aujourd’hui a été bien tardif à s’insurger. Jusqu’en février 1898, Jean Jaurès dort, il tergiverse, et même se montre réceptif au discours des antidreyfusards de gauche…
Il y a pourtant un mythe largement répandu : “A gauche, le cœur nucléaire des défenseurs du capitaine ; à droite, ses ennemis”…
En relisant les textes de cette époque, je me suis aperçu que cette distinction canonique ne tient pas : les choses sont infiniment plus nuancées et complexes. Il est vrai qu’un certain nombre de ténors du socialisme français pensaient qu’ils pouvaient faire un usage politique de l’antisémitisme. Au nom d’une “politique de la trouée”, la passion antijuive devait être une sorte de bélier pour enfoncer les institutions bourgeoises et libérales et faire passer en force la révolution. Et l’un des plus grands d’entre eux, donc, Jean Jaurès, resté une référence de la social-démocratie française, estimait encore au début de l’année 1898 que l’antisémitisme, pour condamnable qu’il soit, pouvait avoir une efficience, une légitimité ! Il avait même flatté les théories conspirationnistes de l’époque en écrivant qu’en France, l’influence politique des Juifs était énorme mais indirecte, qu’elle s’exerçait non pas par la puissance du nombre mais par celle de l’argent. Ce ne sera que quelques semaines après le fameux « J’Accuse… ! », au printemps 1898, que Jaurès embrassera définitivement la cause du capitaine Dreyfus, sous l’influence du bibliothécaire de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, Lucien Herr. D’autres socialistes, en revanche, ne reviendront pas sur l’idée que la dynamique de l’antisémitisme peut participer à l’accélération du combat révolutionnaire : leurs errements ont flétri à jamais le renom de cette utopie.
Cette perception de l’antisémitisme comme levain de la révolution est-elle encore d’actualité ?
Pas au sein du Parti socialiste. Aucun socialiste français, soyons clair, ne dit qu’en s’accommodant du néoantisémitisme, la cause de la justice sociale avancera dans les quartiers de banlieue. Un degré supplémentaire de lucidité sera atteint par ceux des camarades qui accepteront de considérer sincèrement les sinuosités du grand Jaurès. Et ce vieux fond rance d’anticapitalisme dont Proudhon a charrié les effluves. On ne peut malheureusement pas en dire autant de la formation politique de gauche qui concurrence le Parti socialiste, La France insoumise. Dans celle-ci, des personnalités connues et reconnues surfent sur des problématiques qui flattent l’antisionisme larvé ou avoué d’une partie de la jeunesse des cités. On trouve là un cocktail préoccupant : le rejet violent de la laïcité républicaine et de ses obligations par les mouvementistes de gauche et d’extrême gauche, qui jettent, pour certains, des passerelles avec un mouvement profondément réactionnaire comme les Indigènes de la République. Ou encore avec la mouvance décoloniale, à laquelle Gilles Clavreul a consacré récemment une remarquable étude. Un néotrotskisme de quartier, soutenu par le Parti des indigènes de la République (Pir), pense ainsi que l’on séduit la jeunesse issue de l’immigration en tenant un discours systématiquement péjoratif à l’endroit de l’État d’Israël et de ses citoyens. Ces dérives alarmantes ne doivent pas rester impunies. Surtout quand, pour des raisons électorales, des élus de La France insoumise qui ne partagent pas cette orientation se retrouvent contraints à faire des concessions à l’endroit d’un discours islamo-gauchiste que, secrètement, ils détestent. La posture qui vise à considérer à tout propos la République française comme discriminatrice est, en ce sens, également très dangereuse. Cette “politique du Pir” ne dit rien qui vaille… C’est une politique d’incendiaires des âmes.
Quel est ce néo-antisémitisme que vous évoquez ?
Il n’existe pas de définition arrêtée à ce jour, mais c’est un ensemble de prises de position qui participe du retour d’une façon péjorative d’évoquer les Juifs, d’une accoutumance progressive à leur diffamation. J’adhère à la caractérisation donnée par le premier à l’avoir théorisée, le politologue Pierre-André Taguieff. Celui-ci explique que la nouvelle judéophobie est d’abord un effet de cette religion palestinienne qui s’est emparée des meilleurs esprits. Et le vecteur de l’antisionisme, le refus de la légitimité historique d’Israël, est désormais le carburant principal du néo-antisémitisme. Mais on ne peut pas totalement s’en tenir à cette définition : ce serait passer sous silence une composante historique plus ancienne, une forme spécifiquement française d’opposition plébéienne à la République et à sa philosophie, qui s’accompagne toujours de judéophobie.
Deux récits aujourd’hui se partagent ainsi la scène et, malheureusement, ils sont en partie faux l’un et l’autre. Le premier subsiste dans des franges entières de la gauche : celui du palestino-progressisme des années 1970 qui consiste par principe à penser que les démunis auraient tous les droits, car ils sont, comme disait Frantz Fanon, les damnés de la Terre. Mais en face et presque symétriquement, il y a une école de pensée, puissante aujourd’hui, qui assigne entièrement l’antisémitisme actuel à son origine arabo-musulmane. Comme c’est réducteur ! Ne soyons pas hémiplégiques. Je suggère qu’il faudrait arriver à penser que le carburant du néo-antisémitisme est presque autant le produit d’un vieux fond populiste français que celui de préjugés transmis au sein de l’islam intégriste.
Cette “judéophobie à la française” est une thèse de Bernard-Henri Lévy, cité dans vos remerciements, à laquelle vous souscrivez…
Oui. Je la revisite et, vérification faite, elle fonctionne plutôt bien. Selon cette thèse déployée dans l’Idéologie française, il existe deux France : une qui va conduire au vichysme et une qui, très tôt, avant l’affaire Dreyfus, s’oppose à cette évolution funeste, antirépublicaine. Une France des Lumières, qui pense que l’individu a une valeur en tant que tel car doué de raison et capable de s’arracher aux déterminismes culturels et familiaux. Et une autre France qui penche du côté des “anti-Lumières”, comme les a nommés justement Zeev Sternhell, et qui estime que la seule valeur est le collectif. Ces deux France ont existé bien avant l’affaire Dreyfus et je crois qu’elles perdurent aujourd’hui, sous des formes renouvelées. Certains pensent encore que l’humanisme des Lumières a signé une vaste régression. On assiste, me semble-t-il, à la réactivation d’un certain antiélitisme et d’un populisme français, marqueurs culturels communs d’une partie de la gauche extrémisée et de la droite radicale.
Vous ne partagez donc pas la thèse d’Arthur Hertzberg, rabbin américain qui fut un grand penseur du judaïsme contemporain, selon laquelle l’antisémitisme moderne provient des Lumières ?
Cette thèse, assez répandue dans les milieux juifs conservateurs, et que Mgr Lustiger avait, à sa manière, reprise, est intéressante, bien sûr. Forte philosophiquement. Elle consiste à voir dans les grandes catastrophes du XXe siècle, et en particulier dans la Shoah, les conséquences ultimes de l’individualisme rationaliste. Je la crois inexacte et, pour ma part, malgré l’antisémitisme athéiste avéré de leurs philosophes, je suis sensible à l’incroyable potentiel émancipateur qu’ont eu les idées des Lumières, machine à fracturer, fissurer, atomiser les identités fermées, avec l’idée que l’homme n’est jamais réductible à ses origines et à ses attributs essentiels.
Si l’on peut distinguer deux sources d’antisémitisme, on ne peut toutefois mettre sur le même plan deux réalités différentes : l’antisémitisme de droite, lui, ne tue pas…
Aujourd’hui, certes… À l’aune de la capacité à générer de la violence et des forces de destruction, l’antisémitisme traditionnel français, celui des monarchistes et des contre-révolutionnaires, est, en effet, en très net et constant déclin depuis 1945. Taguieff a raison, depuis longtemps, d’avoir prédit son extinction. Ce qui est inquiétant, en revanche, ce sont les nouvelles synthèses, entre les rouges-bruns, les négationnistes, et ces nouveaux courts-circuits idéologiques de ceux qui oeuvrent à une liaison fatale entre l’antisémitisme issu des quartiers (où prolifèrent, trop souvent, l’islamisme et le gangstérisme) et un fond de xénophobie et d’antiélitisme français, sur le modèle Drumont.
Vous évoquiez tout à l’heure l’antisionisme comme “fuel”, ou carburant, de l’antisémitisme. Ne peut-on être antisioniste sans être accusé d’antisémitisme ?
Il est vrai que certaines organisations juives américaines ont réduit un peu trop systématiquement la critique de la politique israélienne à de l’antisémitisme (ce qu’elle est parfois, mais pas toujours). Il ne faut pas tomber dans ce chantage, cette critique est légitime et, quand elle se déploie dans le cercle de l’échange démocratique, elle est nécessaire. Par exemple on ne peut réduire la remise en cause de l’extension des colonies juives de Judée-Samarie à de l’antisémitisme. Et sur le plan théorique, il est aussi possible d’être antisioniste sans être antisémite. C’est le cas de trotskistes des années 1960 ou 1970, comme l’islamologue et communiste dissident Maxime Rodinson qui aimait le peuple juif mais pensait que la création d’un État d’Israël avait été une catastrophe. C’est aussi l’avis d’un Abraham Léon ou, plus près de nous, d’un Edgar Morin. Il existe donc une modalité de l’antisionisme qui est épargnée par l’antisémitisme. Mais c’est une modalité très minoritaire ! La majorité des antisionistes ne reproche pas à Israël sa politique ou la démesure des extensions territoriales en Cisjordanie, mais son existence même. Ils sont donc, de ce fait, antisémites. Et malheureusement, la spécificité du néoantisémitisme est d’avancer masqué, sous le paravent du souci des victimes actuelles, mais derrière il y a la haine d’Israël, haine qui n’a jamais été plus proliférante depuis 1967.
Propos recueillis par
J’accuse ! 1898-2018, d’Alexis Lacroix, Éditions de l’Observatoire, 160 pages, 15 €.
Source www.valeursactuelles.com